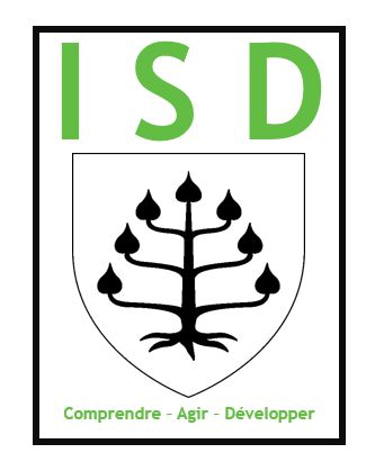Pour une meilleure expérience, privilégiez une visite sur notre site internet avant une version mobile remaniée !
URGENT : PRIVILEGIER UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR MAIL POUR TOUT RAPPEL
Talleyrand ou « l'oracle », décrypté par Charles-Éloi Vial
Charles-Éloi Vial livre une solide biographie du « Diable boiteux », Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, très renseignée, documentée et appuyée sur ses nombreux travaux ainsi que sur l'historiographie récente, nous rappelant que la communauté des historiens de l'épopée des Bonaparte est une veine bien vivante dans l'historiographie française aujourd'hui. Accessible et enrichi par les illustrations, Talleyrand, la puissance de l’équilibre restitue les tumultes du temps et inspire une visite dans le principal lieu qu’il nous a légués, le château de Valençay en Berry.
RELATIONS INTERNATIONALES - GÉOPOLITIQUEHISTOIRE MODERNECULTURE GÉNÉRALE HISTOIREHISTORIOGRAPHIE
Franck Jacquet
5/10/20259 min lire
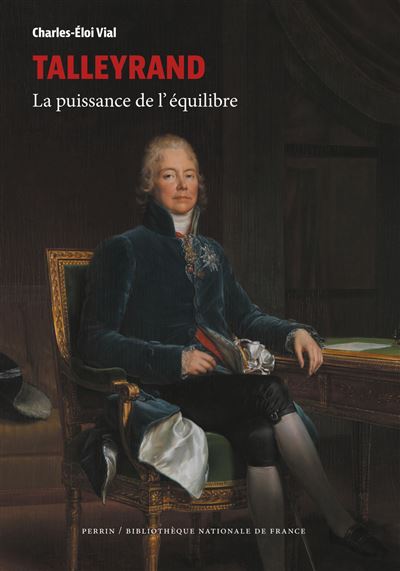
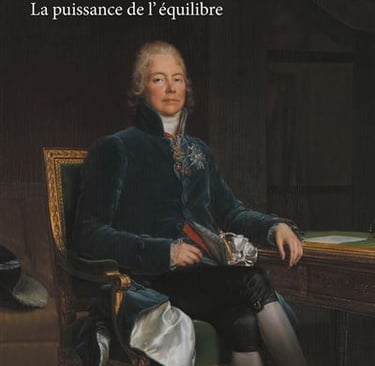
Charles-Éloi Vial livre une solide biographie du « Diable boiteux », Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, très renseignée, documentée et appuyée sur ses nombreux travaux ainsi que sur l'historiographie récente, nous rappelant que la communauté des historiens de l'épopée des Bonaparte est une veine bien vivante dans l'historiographie française aujourd'hui. Accessible et enrichi par les illustrations, Talleyrand, la puissance de l’équilibre restitue les tumultes du temps et inspire une visite dans le principal lieu qu’il nous a légués, le château de Valençay en Berry.
Une biographie solide et classique
Le récit est simple et accessible, ce qui permet de satisfaire à la fois un objectif de vulgarisation et un objectif de diffusion à propos de quelques débats récents de la vie du personnage le plus critiqué, controversé et moqué de la Révolution et de l’Empire. Mais surtout dans le cadre d'un déroulé chronologique, on suit pas à pas celui qu’on représente généralement comme la figure idéal-typique du diplomate traître, ayant survécu à 9 régimes et prêté 13 serments : Charles-Maurice de Talleyrand Périgord.
D'une famille d’antique noblesse, qui remonterait à Boson Ier le Vieux (à la fin du Xe siècle), il est en fait né en février 1754 dans une dans une branche finalement relativement mineure de la grande famille, dont la descendance porte encore aujourd’hui aussi l’apparentement aux Rochechouart. Son père fut notamment distingué à l'issue de la Guerre de Sept ans pour faits d'armes. Il s'agit donc de comprendre que d'emblée, de naissance ce noble et amené à se faire une place dans la société d'un Ancien Régime finissant. Rappelons qu’il déteste ses parents dans la mesure où il doit embrasser une carrière religieuse alors qu'il aspirait aux armes et que son pied, certes difforme, ne m'empêchait pas de pouvoir satisfaire à cet objectif (il souffrait d'un syndrome de Marfan majeur, mais il s’éteignit seulement en 1838). Au séminaire de Saint-Sulpice, comme chanoine à Reims, administrateur des biens de l'Église de France et gestionnaire de ses questions juridiques, il grimpe plus aisément les échelons de l'ordre prieur par son entregent, par sa malice et par son intelligence que par son ascendance ; il s’en remet tout de même au courant qui l’emmène, suivant son oncle, dans le prestigieux archevêché de Reims. Il sait surtout à chaque poste se ménager de nouveaux appuis toujours en remplissant sa tâche avec efficience, sans jamais oublier de se servir au passage autant qu'il sert son institution, et ce parfois par le chantage ou la corruption : il devient un génie du pot-de-vin, selon les coutumes d’une époque où l’on troque les patrimoines pour les positions. Peu importe pour celui qui n'a jamais clairement montré qu'il avait la foi et qui ne se repend qu’aux tous derniers jours de sa vie. Dès 1785, il jouit donc d'un grand carnet d'adresses, ayant notamment négocié avec la royauté un don de l'Église de France au profit d'un budget qu’on sait aux abois (décidemment, la France demeure aujourd’hui bien proche de l’Ancien Régime !).
Au fil de la lecture, celui qui n’est au départ que l'abbé de Périgord, jamais satisfait de sa condition et l'auteur le rappelle, de ses émoluments, n'a de cesse de chercher de nouveaux appuis et de se permettre et de jouer un rôle au-dessus du moment et de ses enjeux, ce que peu sont parvenus à faire durant les années 1790 jusqu'aux années 1810 : c’est sans doute aussi ce qui explique sa longévité ! Mirabeau, comme Charles-Éloi Vial le reprend, juge ainsi très tôt notre homme (vers 1785-1787) : « Pour de l'argent virgule il vendrait son âme, et il y aurait raison, car il troquerait son fumier contre de l'or ». Rappelons l’expression, plus tard, de l’Empereur à son propos : « De la merde dans des bas de soie »… Il passe ainsi tous les régimes de l'Ancien jusqu’à la Monarchie de Juillet. Pour ceux qui lui reconnaissent du talent, de l'intelligence, il est un Oracle. Pour les autres, il est au mieux plein de duplicité ou au pire la figure du Traître qu'on lui rappelle sans cesse : jusqu'à la fin de sa vie on ne cesse de raviver sa place dans la décision de l’affaire du duc d'Enghien de même qu'on le caricature en vieux libertin alors qu'il est octogénaire avec sa nièce Dorothée, comme pour rappeler sa proximité avec le duc d'Orléans dans les dernières années de sa formation. Évêque d’Autun, il grenouille alors pour se construire sa carrière sans se soucier de sa charge et mène une vie de courtisan libertin, ayant lui aussi une brève relation avec Germaine de Staël, avant de plonger dans les États généraux en tant que député du clergé.
L'Oracle
On peut alors se demander quels sont les réels principes de Talleyrand, comme ses contemporains. Derrière une vie nécessairement tortueuse du fait d'une période particulièrement dangereuse, on perçoit que l'auteur cherche à mettre en avant un acteur disposant d'une « colonne vertébrale » tactique voire stratégique. S’il en vient à publier ses Mémoires, Charles-Éloi Vial rappelle qu'il s'est d'abord soucié de se défendre notamment face au Mémorial de de Sainte-Hélène, plutôt que de développer et organiser ses principes en un système. Pourtant, à bien y regarder, son action est largement guidée par quelques idées clés qui définissent en partie ce qu'on appelle aujourd’hui la Realpolitik. Henry Kissinger ne s'y était pas trompé dans son livre Diplomatie. C'est sans doute notamment pour cette raison qu'on ne retient pas Talleyrand au même titre que Clausewitz qui pourtant publie son œuvre au même moment. D’ailleurs l’auteur esquisse que le projet était amorcé, ans le cadre de l’introduction qui n’a jamais été achevée et augmentée comme prévu.
C'est donc sur ce point que le lecteur peut rester sur sa faim. L'évêque ayant de lui-même renié l'Église a tout d'abord toujours été un soutien d'un système politique et institutionnel à l'anglaise (y compris en joignant aux institutions les valeurs et la « politesse des Lumières » : il arbore un phlegme qui le sert bien souvent lors des rencontres houleuses avec des décideurs colériques, et le pire d’entre tous, Bonaparte ! – Rappelons la biographie de Marmont de Franck Favier qui mettait cet aspect bien clairement en exergue). Il reflète mieux alors les élites de la fin de l'Ancien Régime et son anglomanie. S’il a servi Napoléon, l'auteur montre qu’il a très souvent essayé de contenir sa soif de guerre comme il souhaitait que l'expansion de la puissance française se déroule à pas mesurés (c’est le containment repris de Kissinger durant la Guerre froide). On comprend ainsi qu'il cherche à rester, alors qu’il s’est hissé dans les ordres et dignités à celle de Prince de Bénévent, lors de la première chute de l’Empire, le plus haut dignitaire à Paris alors que l’Impératrice et son enfant fuient pour Blois, ce qui lui permet de négocier la paix pour éviter trop de désagréments à la France, pour les Bourbons de retour, mais aussi pour lui qui devient alors une première fois chef provisoire de l’exécutif (ce que Bonaparte, à Fontainebleau, accueille en pestant !). Avec le recul, Talleyrand a systématiquement voulu préserver l'équilibre des puissances sur le continent européen comme il le fit À Vienne lors du fameurs Congrès avec Metternich et à Londres lors de l'indépendance belge entre 1830 et 1832, ce qui est moins connu. Il défendait aussi le principe d'un équilibre neutralisant une grande avancée potentielle de la Russie, ce qui sonne fortement dans notre actualité... Ce sont là au final trois grands prédicats centraux de la diplomatie du XIXe siècle qui débute. Or, si on suit la carrière diplomatique de Talleyrand depuis ses premières armes avec Mirabeau jusqu'à son dernier poste à Londres, si on perçoit bien ces piliers, la biographie met moins en valeur le contexte intellectuel et ce particulièrement les idées diplomatiques dans lequel le « Diable boiteux » était plongé. On en reste à une rigoureuse biographie individuelle et on peut s'en remettre à qui Kissinger ou même à Tolstoï pour élargir la focale.
Cette focale personnelle permet néanmoins à l’auteur de régulièrement rappeler un élément clé sur la personnalité qui nous intéresse ici : ce dignitaire issu des puissants mais ayant toujours été sous la menace de rester impuissant a méthodiquement pris soin dans sa vie personnelle comme dans son engagement politique et de diplomate de jouer sur deux tableaux, l'économique et le politique (et pas simplement ses intérêts et ceux de l’État ou- et du régime : les deux peuvent se recouper). Il met souvent au premier plan le développement ou la reprise des échanges en parallèle des dialogues sur le sort des armes. C'est d'ailleurs pour cette raison, parce que l'économie lui importe finalement plus qu'à d'autres, qu'il était contre la colonisation et particulièrement contre l'expédition d'Algérie à la fin du règne de Charles X. Au-delà du principe d'autodétermination des peuples qu'il défendait comme la première partie de la Révolution, c'était d'abord par l'échange commercial qu'il souhaitait que la France s'étende. C’est une posture finalement moins isolée qu’il n’y paraît (Denis Cogneau, Un empire bon marché, 2023) mais qui lui donne une dimension d’Oracle au-delà de son siècle.
Un texte enrichi
Sans aucun doute, l'ouvrage est publié dans le cadre d'une édition faisant la part belle aux illustrations aux côtés du récit et à de nombreux repères qui rendent la lecture très agréable et instructive. On ajoutera que le format, avant une future parution en poche, renforce l’ergonomie (loin d’un écran !). Tout d'abord, le récit est donc augmenté de très nombreux documents iconographiques, textuels ou d'archives qui ne viennent pas au hasard des pages : ceux-ci sont soigneusement sélectionnés pour permettre de contextualiser, de se représenter, ou de se rapprocher des conditions de vie de l'évêque défroqué. La représentation du pavillon d’Erfurt marque un point tournant, celui de la bascule dans les coopérations avec l’ennemi de Napoléon, et se figurer les lieux de l’entrevue met en avant un épisode clé mais quelque peu moins connu. C'est sans doute là un grand atout de l'ouvrage qui reflète la formation de Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe et conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. On peut aussi voir le contrat de mariage reprographié. De plus, on peut visualiser la galerie de portraits des grands hommes que croise Talleyrand durant sa vie, lui qui côtoya des plus secrets espions au plus grand noble et aux plus grandes têtes couronnées, de Pennsylvanie jusqu'en Russie (la collection est bien « Bibliothèque des Illustres »). C’est là l'occasion de remarques complémentaires qui nourrissent encore plus notre compréhension du personnage ou d’un contexte souvent houleux. Enfin, on apprécie à chaque début de chapitre une citation de Talleyrand ou sur celui-ci, laquelle nous semble proche d'une leçon de vie, sans doute une volonté de l'auteur.
Ajoutons que la biographie s’achève avec un dernier petit chapitre consacré à l'incontournable légende noire de celui qui demeure l'un des inventeurs de la diplomatie moderne.
Pour finir, l'historien dix-neuvièmiste appréciera l'utilisation des correspondances entre Talleyrand et Auguste Thiers, lequel fut d'abord protégé par le premier avant de devenir très rapidement l'un des hommes les plus en vue de la politique française, défendant pour bonne partie le modèle anglais si apprécié de son bienfaiteur. Un autre aspect est la mise en valeur de la dernière partie de la vie du diplomate qui fut longtemps consulté après avoir été démis de sa fonction de chef de Gouvernement durant la Restauration. Malgré la haine qu'il suscitait en tant que membre du clergé jureur, marié, ayant participé à tous les régimes révolutionnaires à l'exception de la période de la Terreur, que ce soit dans sa résidence parisienne ou dans son château de Valençay dans le Berry (dont évidemment il surveillait le rendement et les bénéfices, de l’exploitation des bois à la laine de mouton), bien nombreux furent ceux qui lui rendaient visite pour obtenir quelques bons mots (le sens de la répartie était évidemment un atout) ou quelques conseils pour trancher (sur le fond). D’ailleurs, jusque dans ces dernières heures, l’auteur nous dépeint un homme qui se ménage toujours des points de fuite lorsqu’il s’agit de s’en remettre à un Dieu et d’écrire à un Pape qu’il n’a jamais reconnus que pour la forme !
Applications pour les programmes, les examens et les concours ; ouverture culturelle, voir Moodle ou les Instantanés !
ISD - Paris
Institut Saint Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97 - 09.50.18.63.99
Autres campus :
ISD - Alpes (été / hiver)
ISD - Bourges (automne / été)
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2025 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
Satisfaction (année 2024-2025) :
Satisfaction certifiée auprès des répondants (inscrits élèves, étudiants, auditeurs libres) - Cliquer pour vérifier !
4,1/5