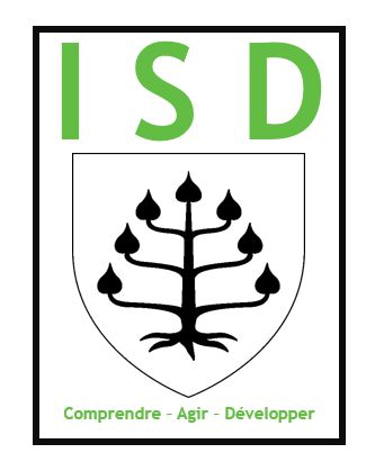Pour une meilleure expérience, privilégiez une visite sur notre site internet avant une version mobile remaniée !
URGENT : PRIVILEGIER UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR MAIL POUR TOUT RAPPEL
La santé et le corps des nations
Au travers de l'histoire des idées et des représentations (économiques, sociales, religieuses, sentiments...), comment le corps individuel est-il appréhendé au travers du groupe, notamment avec la montée du nationalisme et des peurs nationales ? La question sous-jacente des solidarités est bien présente, dans le cadre de la formation stato-nationale...
THÉORIE DES NATIONALISMES PHILOSOPHIEHISTOIRE MÉDIÉVALERELATIONS INTERNATIONALES - GÉOPOLITIQUESCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES GÉOGRAPHIECULTURE GÉNÉRALE HISTOIRESOCIOLOGIEECOLES DE COMMERCESCIENCES POLITIQUEQUESTIONS CONTEMPORAINES
Franck Jacquet
7/23/202439 min lire


Introduction
« L’Europe est très contagieuse » : c’est par cette expression que C. Grataloup cherche à résumer la mondialisation des maladies européennes en lien avec ce qu’on nomme les « Grandes découvertes ». En effet, cette phrase reprise de Klaus Mann, fils de Thomas Mann, illustre bien le fait que l’Europe, bassin épidémiologique en fait compris plus largement dans l’Ancien monde, exporte ses maladies pour développer sa domination, ses modes d’exploitation et d’appropriation du territoire…
Pourquoi partir de cette image ? Parce qu’elle illustre la démarche qui sera étudiée ici : l’objet est l’étude des discours sur la santé des nations et des Etats, la manière dont on perçoit l’état de santé d’un ensemble politique et social puis culturel. Dès lors la santé de l’individu est comme une partie de la santé d’un grand tout. Cela révèle la manière de voir le monde, la manière de le comprendre et de se l’approprier, ce qui explique les modes de vie des hommes, leurs croyances, leurs structures politiques… ce que Hegel nomme la Weltanschauung. Parfois, on mêle Etat de santé de l’Etat et santé des populations, ce qui engendre une autre manière de développer les politiques publiques de santé. Nos représentations ont été heurtées, remises en cause par les bouleversements de la période Covid. Des représentations anciennes, héritées du temps long, sur le corps, la santé, la maladie, ont alors affleuré. Mais avec le choc de l’ouverture du monde et la modernisation des représentations liée à la mondialisation occidentale, les anciennes représentations avaient semblé disparaître.
On peut repartir d’un syllogisme simple :
o On considère qu’un État, une société politique instituée, est en « bonne santé » lorsqu’il est puissant.
o Une grande évolution, celle de la mondialisation et de la sécularisation, se produit dans la manière de lire le monde entre le XIVe siècle et le XXIe siècle en Europe.
o Alors que la santé d’une société politique instituée est perçue sur le plan religieux dans un premier temps, les inégalités de puissance sont perçues à travers le prisme de la mondialisation et de ses mécanismes.
Dès lors, en quoi les discours sur la santé d’une nation reflètent-ils les manières de voir le monde, de le comprendre, de le croire et de se l’approprier (Weltanschauung) ?
1 : Dans les sociétés prémodernes, l’État comme grand corps :
Dans les sociétés antérieures à la déchristianisation, l’Etat et son positionnement par rapport aux autres n’a pas de sens car il n’y a pas de relations internationales au sens où nous l’entendons aujourd’hui. L’état de santé de l’Etat est celui de ce qui incarne le principe de souveraineté. Dans ce contexte, les métaphores organicistes sont légion et caractérisent ce qu’on entend par puissance. Dans ce cadre, la population en tant que telle n’est pas vraiment considérée car le principe national n’existe pas, il prend un autre sens ou il n’est qu’embryonnaire.
A : Le corps ne compte pas… tant qu’il est mortel :
1 : Les « deux corps du roi », métaphore de la permanence de l’État :
Les Etats européens ne sont que des embryons à l’époque médiévale et ils ne se détachent que progressivement des deux grandes souverainetés concurrentes qui cherchent à dominer l’ensemble de la Chrétienté, la Respublica Christiana, seul cadre logique pour l’exercice du pouvoir : le pape et l’empereur.
L’empire carolingien s’était accordé avec la papauté au IXe siècle. Du XIe au XIVe siècle, ce n’est plus le cas et l’Empereur germanique ainsi que le pape de Rome luttent sans cesse pour avoir la prééminence du pouvoir. S’opposent deux lectures de l’exercice de la souveraineté : la thèse de Gélase (pape de Rome) considérant que l’empire englobant s’est effondré avec Rome au Ve siècle et la thèse d’Eusèbe de Césarée, père de l’Eglise de la fin de l’antiquité, qui considérait au contraire que c’était l’empire qui englobait et réalisait le destin de la Chrétienté, qui permettait d’étendre la bonne nouvelle et donc de réaliser le destin du christianisme. Cette lecture du monde est avant tout chrétienne. La hiérarchie et donc les inégalités entre puissances ne sont à lire qu’en fonction, essentiellement, de leur légitimité religieuse.
Dans ce cadre d’affrontement, les souverains locaux tirent leur épingle du jeu et s’affirment. Ainsi les rois peuvent devenir de vrais souverains, s’autonomiser. Les Capétien en France, les Plantagenêt en Angleterre, les rois de Hongrie mais aussi ceux d’Aragon… mais aussi les cités-Etats italiennes ou allemandes s’autonomisent au sein de la Respublica Christiana en s’appuyant alternativement sur l’un des deux grands. Par exemple en France, en 1214 à Bouvines Philippe Auguste vainc le roi d’Angleterre et l’empereur, devenant ainsi définitivement « empereur en son royaume ». Un siècle plus tard, Philippe le Bel impose sa domination à l’Eglise de France et donc sa prééminence sur le pape en l’affrontant à plusieurs reprises sur la question de l’imposition de l’Eglise et la nomination des évêques. Ce mouvement reflète bien d’autres processus d’autonomisation politique des Etats mais dans le cadre de la Chrétienté (royaumes…).
Mais comment légitimer ceci et comment considérer que le royaume est ainsi permanent, aussi immortel que la dignité pontificale ou impériale, les plus saintes ? Les rois cherchent alors à s’approprier une légitimité religieuse ou charismatique (distinction wébérienne). Les rois signifient leur charisme et leur légitimité par le sacre, rite se développant à partir du VIIe – VIIIe siècle, d’abord chez les Wisigoths puis particulièrement en France mais aussi ailleurs. Le sacre reflète la double nature de la personne royale selon Ernst Kantorowicz (Les deux corps du roi). Il y a un corpus mysticum, le corps spirituel du roi qui en fait ne meurt jamais, incarne la continuité de l’Etat et s’incarne différemment et successivement par les personnes royales qui sont le corps naturel de chaque personne. La fiction de continuité de l’Etat passe donc par le religieux. Le royaume ne meurt jamais tant que la dignité royale, matérialisée par les regalia, objets du pouvoir (couronne…) sont transmis dans le cadre des rites. Surtout, le souverain sacré a des pouvoirs magiques que les autres n’ont pas, ceux notamment de guérir. C’est le pouvoir thaumaturgique étudié par Marc Bloch (Les rois thaumaturges). Chaque roi sacré a des pouvoirs : les écrouelles pour le roi de France, touchant et guérissant les scrofules, le roi de Hongrie pouvant guérir la jaunisse… La légitimité royale se traduit donc, dans le cadre de cérémonies, par le pouvoir de guérir.
La métaphore des deux corps du roi et son corolaire, le pouvoir de guérir, servent donc à affirmer l’autonomie voir des hiérarchies de pouvoir au sein de la Chrétienté médiévale.
2 : Le corps naturel importe peu… :
Le corps naturel, mortel, importe donc peu. C’est la continuité qui compte à travers les objets du pouvoir, les rites, les symboles dynastiques (Georges Burdeau). La santé et les maladies, dans des sociétés où la médecine est plus que rudimentaire, sont abordées bien souvent par le religieux, les techniques des antiques ayant été mises de côté. La santé du corps, qu’elle soit celle du souverain ou celle de l’individu compte donc peu. Elle n’est que le reflet de la santé de l’âme et donc de sa capacité à être un bon chrétien. Cela ne signifie pas que la médecine soignant le corps n’existe pas en tant que telle, mais elle n’est qu’une partie du soin premier, celui de l’âme.
Ainsi dans des sociétés où l’espérance de vie est courte, c’est au soin des âmes qu’on s’attelle le plus : chacun s’y exerce quotidiennement mais c’est aussi le rôle d’un corps institué et sensé être le premier de la société, l’ordre religieux, qui ne cesse de s’étoffer au Moyen Age avec le développement des ordres monastiques. On observe que chaque ordre (Cluny, Cîteaux, Franciscains…) se forme sur une profession de foi où le fondateur (Bernard, Benoît d’Aniane…) affirme la nécessité de prier dans les bonnes formes et le fait de recréer la règle initiale suivie pour prier ou de l’améliorer pour guérir un ordre monastique, une communauté religieuse malade d’une mauvaise observance (règle de l’ordre de Cîteaux).
Le corps naturel importe peu directement, mais il compte en ce qu’il est le reflet de la santé de l’âme et par âme on comprend la foi. Le corps est donc pris dans un système que renforce la réforme grégorienne, prenant en compte les efforts des ordres qui régulent, enserrent, cherchent la scansion habituelle pour que le corps puisse pleinement recevoir et entretenir la foi.
3 : … Mais l’infirmité empêche la souveraineté :
Pour autant le souverain, celui qui mène son Etat ne peut être légitime s’il est touché par certaines maladies ou certaines infirmités. En tant que celui qui ceint les objets sacrés, les reliques ou protège la foi, il ne peut être lui-même dégradé. La figuration de son autorité ne peut être entachée d’une infirmité. Plusieurs cas témoignent de ce que les défaillances du corps mortel – naturel du roi sont un prétexte pour un changement politique, en considérant que le corps naturel déficient reflète l’atteinte au corps mystique du souverain :
r Dans l’empire byzantin médiéval, tout concurrent écarté à la dignité de basileus (Ducellier) est atteint dans son corps pour ne plus pouvoir, logiquement, revenir au pouvoir, un corps amputé étant considéré comme une indignité insurmontable. L’habitude est de couper le nez, les oreilles…
r Le roi de Jérusalem Baudouin IV de Jérusalem au XIIe siècle (Pierre Aubé, Baudouin IV de Jérusalem, le roi lépreux, 1981), roi lépreux, ce qui le délégitime tant auprès des latins que des musulmans sous sa domination.
r A lire les actes de déposition ou d’excommunication, la question de la santé est abordée par celle de l’âme du souverain. La santé de la chrétienté et son état général est affecté par un mauvais souverain. Un empereur ou un pape dépose donc un autre souverain en considérant qu’il est devenu proprement infirme pour mener à bien les âmes dont il a la charge (pouvoir pastoral). (http://sourcesmedievales.unblog.fr/). Ex : Bulle – sermon sur la déposition de l’empereur Frédéric II en août 1245.
B : Les organes du corps de l’État :
1 : La société politique, un tout organique où l’inégalité est logique :
Les sociétés prémodernes sont en effet des « tout » organiques. L’individualisme tel qu’on le connaît n’existe pas réellement. La lecture du monde étant religieuse et étant liée à un monde agricole, dans lequel l’espérance de vie est courte, c’est par ces grilles de lecture qu’il faut comprendre qu’on conçoive inégalité ou problème de santé.
r L’inégalité est logique et naturellement instituée : la société est un tout organique, comme un grand corps. Ce grand corps est divisé en trois parties, les prieurs, les guerriers et chevaliers qui défendent et ceux qui produisent, le monde paysan. L’inégalité de droits, de traitement, de ressources est donc logique puisque chacun a des droits et devoirs en fonction de sa place dans la société, celle-ci étant conçue comme un agrégat de communautés locales, de paroisses.
r La santé d’une société est donc conçue par le bon équilibre entre ces trois ordres, même si ceux-ci sont bien plus mobiles et moins structurés que dans la monarchie absolue du XVIIe siècle. Si une partie du tout en vient à être malade, c’est l’ensemble de la société qui devient malade. Cet aspect est très important.
r Dans ce cadre le souverain est désigné à travers des métaphores organicistes, c’est-à-dire qu’on compare un phénomène social, politique… à un aspect corporel, médical (organicisme, organe). Le roi est désigné successivement comme le cœur ou le bras (de justice, armé…) ou alors la tête qui anime l’ensemble du royaume. Évidemment, sauf exception (une monarchie élective comme en Pologne par exemple), si le roi est malade, c’est l’ensemble du corps qui est touché par la maladie (ex : la folie de Charles VI, roi du début XVe siècle, qui en vient pendant la guerre de Cent Ans à voir son royaume partagé par le traité de Troyes en 1420).
Non seulement au sein de la société encastrée dans le religieux, il est logique de concevoir des inégalités comme constitutives de l’ordre social (comme dans le cadre d’une société de castes), mais ces inégalités ne peuvent être surmontées sans quoi elles amènent à déséquilibrer l’ensemble de la société politique, ainsi malade.
2 : Une société prenant part dans un vaste ensemble, la Respublica christiana :
Alors comment considérer l’ordonnancement et les inégalités entre royaumes et Etats médiévaux ? La difficulté est réelle car la fiction de l’unité de la Chrétienté demeure jusqu’aux guerres de religion (Jean Picq). Les inégalités ne sont pas concevables entre sociétés politiques en ce que certaines seraient plus développées que d’autres, plus puissantes… Ainsi, les textes médiévaux parlent de richesses pour des parties de royaume, des villes à foires… mais pas pour des entités politiques à part entière. De plus, la valeur de partage, le rejet de la richesse temporelle pour mieux atteindre le Paradis marque la Chrétienté.
Il n’y a donc pas d’ordre international à proprement parler :
r La fiction de l’unité chrétienne est maintenue en Europe malgré les concurrences. Cette unité est réaffirmée par les guerres saintes ou justes, les croisades qu’elles soient internes (Albigeois et Vaudois pour soigner la Chrétienté elle-même) ou externes (croisades au Levant ou en Afrique du Nord).
r Une concurrence s’exerce néanmoins pour voir quel est le roi le plus saint, le meilleur défenseur de la Chrétienté. On use alors de tous les procédés de légitimation possibles, jusqu’à avoir des rois saints. Saint-Louis en France au XIIIe siècle… Surtout, il y a concurrence entre le XIe et le XIVe siècle pour collectionner les objets de la passion et des saints, avec l’érection de saintes chapelles.
Dès lors, un symbole de puissance relève de la qualité ou de la quantité des restes de corps ou des tenues récupérées de saints, voire de Jésus lui-même. Les reliques font alors l’objet d’une intense convoitise, celles-ci pouvant, avec leur arrivée dans un royaume, le « soigner » (abbé Suger).
3 : Le bien commun de l’État et des peuples, mission du souverain :
Dans ce cadre, la concurrence entre souverains est réelle, on ne peut la nier, mais elle est toujours habillée et imprégnée de ces éléments de légitimation chrétienne. Le souverain qui soigne le corps de ses états, de son royaume est celui qui accomplit le « bien commun ». Ce bien commun est défini progressivement durant le Moyen Age sur une base religieuse mais est porté à sa formulation la plus aboutie par Thomas d’Aquin au XIIIe siècle (Somme théologique).
Extrait :
« Toute loi […] vise l'intérêt commun des hommes, et ce n'est que dans cette mesure qu'elle acquiert force et valeur de loi ; dans la mesure, au contraire, où elle ne réalise pas ce but, elle perd de sa force d'obligation […]. Or il arrive fréquemment qu'une disposition légale utile à observer pour le bien public, en règle générale, devienne, en certains cas, extrêmement nuisible. Aussi le législateur, ne pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige-t-il la loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent, portant son attention sur l'utilité commune. C'est pourquoi, s'il se présente un cas où l'observation de telle loi soit préjudiciable à l'intérêt général, celle-ci ne doit plus être observée. Ainsi à supposer que dans une ville assiégée on promulgue la loi que les portes doivent demeurer closes, c'est évidemment utile au bien public, en règle générale ; mais s'il arrive que les ennemis poursuivent des citoyens dont dépend le salut de la cité, il serait très préjudiciable à cette ville de ne pas leur ouvrir ses portes. Et par conséquent dans une telle occurrence, il faudrait ouvrir les portes, malgré les termes de la loi, afin de sauvegarder l'intérêt général que le législateur a en vue. »
Donc :
r Le roi est pasteur, il mène les âmes au salut comme un berger (pouvoir pastoral) (Michel Foucault).
r Le roi doit accomplir le bien commun, prendre en compte une forme d’intérêt général qui le dépasse mais qu’il incarne.
r Il n’y a pas d’intérêt particulier dans le cadre d’un tout organique, la société médiévale chrétienne est un corps unique.
r Le roi se place dans le cadre de la communauté des chrétiens et l’État royal n’existe que comme un moyen et non comme une fin. Il y a une méfiance envers la bureaucratie et l’État particulier.
La formulation la plus évidente de l’accomplissement du bien commun est perceptible dans les fresques d’Ambrogio Lorenzetti de Sienne (les effets du bon et du mauvais gouvernement), dans les années 1330. Elles légitiment le gouvernement de la cité, la Commune, contre les seigneurs locaux, en ce que la cité accomplit le bien commun, ménage la santé et l’état sanitaire des populations parallèlement à leur âme… (Patrick Boucheron, conjurer la peur). On perçoit dans cette éclosion de la fin du Moyen-Âge la prise en compte du plaisir du corps lorsque la paix sociale et religieuse est assurée par les vertus (théologales et cardinales).
C : Quelle place pour la nation ?
1 : Les sens premiers du terme « nation » :
Dans ce cadre la nation n’a pas le sens contemporain, ni même le sens moderne qu’elle a acquis progressivement.
La nation désigne, par le terme natior, une origine, une provenance. Elle ne donne jamais droit systématiquement à des droits, ne supporte pas nécessairement d’identité commune et est encore moins reliée à la notion de légitimité royale.
A l’époque médiévale, la nation n’est appliquée dans les droits que pour définir des droits particuliers, au coup par coup, dans des situations particulières. Par exemple, les droits des étudiants sont quelque peu différents selon la nation dont ils proviennent à la Sorbonne, l’université médiévale étant composée de quatre nations différentes, parce qu’elles parlent des langues vernaculaires différentes (normands, picards…). Mais ce ne sont que des droits limités au temps de l’étude… Corps et corporation sont alors plus que jamais liés.
2 : L’inexistence d’un « ordre international » :
Il y a évidemment des intérêts et des hiérarchies entre Etats. Ailleurs que dans le cadre du droit que l’on reprend de Rome (au XIe siècle avec la reprise du Code Justinien qui compile, les glossateurs créent les siècles suivants des « corpus » juridiques pour faire évoluer la tradition juridique), la nation n’a pas de sens, les rois gouvernent sur des peuples dont d’ailleurs ils ne proviennent pas nécessairement, parce que les royaumes et les fiefs sont leur patrimoine (domination patrimoniale étudiée par Perry Anderson dans Lineages of the absolutist State). Les édits sont rendus à destination des « peuples » ou à un corps constitué (les bourgeois, les sabotiers, les tanneurs…) et non en lien avec une nation. La légitimité nationale n’a donc aucun sens dans une société européenne prémoderne, les prémices d’une identification nationale n’étant pas à proprement parler perceptibles avant la Guerre de Cent Ans au XVe siècle dans le cas de la France par exemple. Il n’y a pas d’ordre et de hiérarchie, encore moins d’inégalités dans un tout organique, la communauté des chrétiens. Il n’y a donc pas d’ordre international.
Les sociétés prémodernes européennes pensent donc l’inégalité comme une logique de leur organisation en ordres et en castes. Ces sociétés segmentées sont régies par l’idée selon laquelle la santé temporelle ne compte guère du moment que l’on soigne l’âme et ses maux et ce grâce notamment à un pouvoir légitime. Le bien-être n’est ni conservation, ni conçu par rapport à un niveau relatif d’inégalités, mais par rapport à des absolus, particulièrement un point fixe, le Dieu aristotélicien médiéval, point fixe autour duquel tout doit s’organiser.
2 : La rupture de la modernité et ses conséquences :
Aux XVIe et XVIIe siècles, la Respublica christiana s’effondre et le monde doit peu à peu être conçu comme un espace d’interactions et de concurrences entre puissances souveraines dans un espace s’ouvrant : c’est l’émergence d’une mondialisation conçue autour d’un droit des gens moderne. Les sociétés politiques que sont les Etats européens doivent alors se remettre en cause, le cas de l’Espagne et des thèses populationnistes étant les plus intéressantes de ce point de vue. Sur le long terme, c’est donc une lecture peu à peu détachée du principe religieux qui s’impose pour comprendre la place d’un État dans le concert des nations, malgré les résistances des absolutismes et despotismes éclairés.
A : L’émergence du droit des gens parallèlement au choc de l’ouverture du monde :
1 : Le rôle de la Réforme :
L’écosystème de la Chrétienté médiévale s’effondre finalement avec la réforme religieuse et le protestantisme, les guerres de religion :
r Au XIVe siècle déjà, les théologiens comme Marsile de Padoue ou Guillaume d’Ockham dénoncent une Chrétienté malade de ses divisions, la fiction d’unité et d’égalité entre croyants étant de plus en plus battue en brèche par les affrontements internes ou encore la très grande déstabilisation occasionnée par la Grande Peste des années 1340-1350 qui décime le continent (entre 33% et 50% de la population européenne disparaît ; les résurgences de pestes ensuite continuent de déstabiliser les communautés villageoises comme les villes, mais plus généralement les administrations…). Ils prennent acte du déclin de l’unité chrétienne et de la nécessité de redéfinir cette unité. Leurs textes sont empreints de métaphores organicistes montrant combien la société chrétienne est conçue comme malade, gangrenée… La crise de foi est toujours au centre de leurs préoccupations. D’ailleurs les premiers humanistes s’attachent à « guérir la foi » pour la réformer de l’intérieur et éviter les remises en cause plus radicales. Ces tentatives, notamment portées par Erasme, sont nommées devotio moderna. Elles ne parviennent pas à résoudre les divisions, d’ailleurs de plus en plus importantes (ex : le corps chrétien est coupé en deux par le Grand Schisme d’Occident – 1378-1417).
r Surtout, la Réforme de Luther puis de Calvin notamment prend acte de la nécessité de rompre avec l’unité d’une Respublica christiana malade des indulgences, du culte des saints… 1517 sonne comme le début de l’éclatement de cet ensemble organique en décomposition avancée (Jean Picq). Les Institutions de la religion chrétienne de Luther remettent complètement en cause l’idée d’un bien commun à tous les chrétiens défini selon le cadre de l’Aquinate.
r Les guerres de religion, dont l’appellation est aujourd’hui critiquée, nuancée, se développent entre les années 1530 et la fin du XVIe siècle mais aussi plus largement avec la Guerre de Trente Ans entre 1618 et 1648. Elle amène à l’abaissement complet de la prééminence pontificale, de l’empire désormais divisé entre quelques 350 principautés, à l’alliance possible entre des puissances catholiques avec des protestants pour la pure raison d’État… Les traités de Westphalie en 1648 consacrent la division religieuse de l’Europe mais surtout le principe de cujus regio, ejus religio.
C’est donc un ordre entre Etats territoriaux concurrents et sans prééminence autre qu’un rapport de forces qui se met en peu à peu en place, le ferment de l’unité étant désormais définitivement enterré.
2 : Une première mondialisation :
Parallèlement la conception de l’inégalité ou de la hiérarchie des ensembles politiques est battue en brèche par l’extérieur, par la découverte du Nouveau Monde. L’explication religieuse du monde, unitaire, où s’opposent les croyants et les infidèles, incarnés par les deux autres religions du Livre, est abattue par la découverte de nouvelles populations qui n’étaient pas présentes dans les Écritures et dont il faut bien tenir compte. La première mondialisation (Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde) amène là aussi à une remise en cause du tout organique considéré par la lecture chrétienne du monde.
Ce facteur est un corolaire indispensable à prendre en compte pour comprendre l’effondrement de la manière dont on percevait l’ordre des Etats et leur santé, les inégalités entre peuples ou au sein des peuples.
L’exemple le plus évident est la controverse de Valladolid : dans cette grande université espagnole, les théologiens, Bartholomé Las Casas et Jean de Sepulveda notamment, s’opposent en 1550 sur le statut des Amérindiens (incas…) conquis par les Conquistadores et soumis dans un premier temps au régime de l’encomienda, forme de féodalité implantée dans les Amériques mais où le seigneur conquistador bénéficie d’un pouvoir encore étendu. En effet la question est de savoir que faire des âmes de ceux qui sont découverts et qui n’existaient pas selon les croyances d’alors. Sont-ces des animaux ou sont-ils des hommes à convertir et dont l’état doit être maintenu pour étendre la Chrétienté ? L’Église est évidemment favorable à la conversion des âmes pour étendre la Chrétienté. Cette option finit par primer, en se fondant sur la conception des droits naturels, ceux qui existeraient sans que soit nécessairement présent un ordre institué (droit à la vie…). Cela permet d’alléger le système de l’encomienda et donc de prendre en compte la préservation de l’état sanitaire et physique des Amérindiens dont on peut rappeler que, selon les lieux, entre 50% et 90% de la population a disparu en un siècle de conquête européenne (Pierre Chaunu, L’expansion européenne du XIIIe au XVe siècle). Aussi, les historiens de la santé ont démontré que corps et droits évoluent alors : la controverse porte parfois sur les manières de se mouvoir des Amérindiens, sur leurs nourritures, leur taille, leur poids… On cherche à les mesurer non pas par rapport à la religion dans un premier temps mais avec des outils relevant d’une « observation scientifique » (justement pour ensuite quel lien établir avec la religion), ce qui fait qu’un regard nouveau naît sur le corps. Les prêtres envoyés dans les nouvelles Indes sont les premiers à recueillir par des enquêtes « anthropologiques » les données sur les cultures d’ailleurs (ils en préservent quelques traits par leurs descriptions, parfois mêlées de magie).
3 : Comment classer les sociétés dans un monde ouvert ?
Il faut donc repenser un ordre cette fois international non pas en ce qu’il y a des Etats-nations proprement constitués, mais en tous les cas un ordre interétatique ou chacun peut avoir autant de légitimité qu’un autre.
Le cas de Valladolid est éclairant sur le renouvellement de l’ordre qu’on doit concevoir dans une échelle bien plus large désormais que celle de l’Ancien Monde.
L’école de Salamanque qui promeut la rénovation de la conception des droits naturels fait émerger le droit des gens. Francisco de Vitoria, théologien de l’université, définit au XVIe siècle que l’ancienne unité de la communauté chrétienne a vécu et que donc les inégalités de puissance, les rapports de force doivent être régulés d‘une nouvelle manière : le pape n’a pas de prééminence sur les souverains puisque il n’y a pas d’unité chrétienne. Chaque souverain doit donc réguler en son sein l’État des choses et une « république humaine » devrait être instituée pour réguler les rapports entre les souverains.
Ce droit des gens est une première formulation du droit international devant réguler les rapports de forces entre les Etats, formulation développée ensuite par Grotius (Le droit de la guerre et de la paix) ou Pufendorf au XVIIe siècle, alors que le religieux ne peut plus être le principe régulateur des relations entre Etats.
Les hiérarchies et inégalités entre Etats sont désormais peu à peu régulées sur une nouvelle conception de l’ordre international, et notamment sur une nouvelle définition de ce que peut être la « guerre juste » (première manifestation des rapports de force entre Etats), qui était jusque-là définie sur un mode uniquement religieux.
B : L’exemple de l’Espagne du siècle noir, le XVIIe siècle :
1 : Une société malade ?
Le cas de l’Espagne, sa place dans ce mouvement est intéressante à observer car elle est, un temps, le cœur de cette économie-monde moderne atlantique. Mais elle ne l’est que temporairement, durant le siècle d’or du XVIe siècle (F. Braudel, La Méditerranée au temps de Philippe II) et entre très vite en crise, s’épuisant dans les querelles religieuses en Europe (le cas de Charles Quint est évident). Ainsi, dès le XVIIe siècle, vivant mal son déclassement européen, la société espagnole se perçoit comme malade. Un ensemble de discours sur les maux de la société espagnole se développent et reflètent le déclin de l’ancienne lecture du monde.
r Les maux touchant la société espagnole :
o L’Espagne voit l’or circuler mais tout part en affrontements avec la France ou avec les Provinces-Unies naissantes, voire l’Angleterre… C’est donc une série de revers que l’Espagne connaît à partir de la fin du XVIe siècle.
o Les résurgences de pestes ou pestilences sont particulièrement importantes et dépeuplent, déstructurent des régions entières, comme la Manche ou la Nouvelle Castille. Elles marquent tout le siècle. La dépopulation est réelle : si la population ibérique pèse 10% de la population européenne au début du XVIIe siècle, elle n’en vaut plus que 6% à la fin.
o La question religieuse est un problème ancien, l’Espagne de la reconquête s’étant appuyée sur l’Inquisition pour réduire la place des Morisques, des Juifs ou des convertis. Les tensions du XVIIe siècle ravivent de manière évidente ces interrogations religieuses.
r Les discours des intellectuels se développent donc sur la maladie profonde de la société ibérique, le monde ibérique étant conscient de son déclin (Henry Kamen, Spain, a society of conflict, 1999. Vitoria ou le théâtre de l’époque en sont les témoins (Lope de Vega).
La maladie de la société, ou la maladie du corps, est à la fois celle de son économie, de sa foi (piété tridentine), de sa politique extérieure et de ses conceptions culturelles. La société se perçoit elle-même comme gangrenée.
2 : Une société d’inégalités reformulées et systématisées :
Cette crise proprement vécue est donc l’occasion de creuser les inégalités. L’ancien discours chrétien englobant et amenant in fine à l’égalité de tous, même si celle-ci était fictive, et même si elle s’appuyait sur une inégalité sociale – temporelle (société d’ordres) n’est plus. Mais si le discours religieux ancien doit être reformulé, la manière organiciste de percevoir la société comme un tout demeure et donc l’idée d’une société malade comme l’est un individu prédomine. L’idée du corps malade engendre sur le siècle une réponse systématique, l’isolement et la coupe pour éviter la gangrène de ce qui n’est pas encore corrompu.
Deux exemples sont éclairants :
Sur le plan religieux : la société se perçoit comme gangrenée par la division religieuse. L’héritage de la reconquête est réactivé. Logiquement, musulmans non convertis et juifs sont expulsés en 1492 par Isabelle la Catholique.
La crise réactive les peurs de contamination, de maintien de la religion de l’ennemi comme moyen d’affaiblissement du corps, comme un virus.
Ainsi la solution est l’amputation : les Morisques, ceux considérés comme de faux chrétiens sont expulsés : plus de 300.000 personnes sont expulsés et leurs biens confisqués, purifiés, dans les régions de Valence et d’Aragon entre 1609 et 1614. Le chiffre est impressionnant.
Plus généralement, juridiquement on renforce et systématise les inégalités de droits envers ceux qui sont suspectés de ne pas être de bons chrétiens. Concrètement, il existe depuis le XVe siècle des procédures juridiques qu’on nomme « limpieza de sangre » (pureté de sang), procédures juridiques par lesquelles on prouve qu’on est un vrai, ancien chrétien pour conserver ses droits et ses biens. Cette procédure est menée par l’Inquisition. Elle est renforcée et systématisée et sert à isoler toute personne suspectée au sein d’une paroisse, d’une communauté villageoise au XVIIe siècle pour éviter que le mal ne se répande. (Augustin Redondo, Les problèmes de l’exclusion en Espagne).
Sur le plan politique, en termes de relations avec les autres Etats, le repli est assez évident. L’Espagne doit se désengager de plusieurs terrains d’opération (frontière catalane, partie Nord des Pays-Bas espagnols, croisades en Afrique du Nord) pour éviter que l’ensemble du corps monarchique, l’État, ne décline. C’est le renoncement à l’empire chrétien universel dès le XVIe siècle, définitif au XVIIe siècle.
Sur le plan local, une mixophobie commence à se développer dans certains comptoirs et grands ports : les métissages sont de plus en plus mal vus dans une partie du monde ibéro-américain.
C’est donc le repli et l’amputation qui prédomine. Les métaphores chirurgicales sont légion pour expliquer les solutions à apporter. Le texte de Campanella est très éclairant, évoquant la stérilité, les infirmités…
A terme, on constate que le discours religieux sert plus pour isoler, justifier et systématiser les inégalités économiques, sociales, juridiques, politiques, plutôt que pour unifier. Le retournement historique autour de l’idée de maladie est impressionnant.
3 : Soigner les maux de la société ; les thèses de la recouvrance :
Qu’en retenir pour comprendre le glissement de la manière dont on perçoit la santé d’une nation et des humains durant les XVe - XVIIe siècles en Espagne ?
r Il y a fermeture religieuse et justification des inégalités par la religion donc.
r Les thèses de la restauration de l’économie et de l’état de la population se développent cependant durant ces siècles. Parfois proches des thèses mercantilistes ou bullionistes (René Passet, Les grandes représentations du monde et de l’économie), les thèses populationnistes émergent. Elles cherchent à définir des « cures » différentes pour la société espagnole, pour surmonter ses maux. Sans se libérer de l’organicisme assimilant corps et population, elles développent des idées de de recouvrance, censées développer une « convalescence » pour la société. Encore une fois, ces termes organicistes irradient ces idées. Elles cherchent à développer l’agriculture, répartir les ressources localement pour limiter les inégalités, développer de nouvelles activités notamment des fabriques et des manufactures sur le modèle colbertiste. Systématiquement, elles cherchent aussi à assainir le paysage pour assainir la société. Par exemple, sur la côte méditerranéenne, les résurgences de paludisme ne sont pas rares. Les populationnistes lient systématiquement assainissement des côtes à marais, de la population, de ses croyances et de son système de production. Tout est lié, mais la mise en valeur économique devient une fin en soi pour retrouver santé et prospérité.
Les deux textes relatant la crise espagnole et ses causes illustrent bien ce glissement qui est d’ailleurs plus général, continental. La lecture des inégalités comme des maux devient une lecture économique, ancrée dans un État territorial voire national, et où le religieux n’est plus qu’un facteur explicatif de la situation parmi d’autres.
C : Résistances organicistes et déclin du religieux :
1 : Les absolutismes et le maintien des formules englobantes :
Les absolutismes sont d’une manière ou d’une autre, dans les différents Etats, des solutions pour expliquer les inégalités internes, les systématiser à la suite de la désorganisation occasionnée par la rupture de l’unité religieuse, et pour expliquer la position d’un État dans le concert des nations européennes en gestation au XVIIIe siècle et en cours au XIXe siècle. Les absolutismes maintiennent chacun comme ils le peuvent des formulations englobantes. Ils s’appuient toujours et systématiquement sur une perception organique de la société. L’exemple de la Métropolitée l’illustre parfaitement : dans ce texte, Alexandre Le Maître au XVIIe siècle décrit toute la société et les peuples du royaume sous l’angle d’un grand corps. L’organicisme est poussé en système destiné à montrer à quel point les règles du corps régissent les manières d’évoluer d’un État.
Dès lors, on justifie donc les inégalités d’ordres et on les systématise dans le cadre de l’Ancien Régime où les ordres sont bien plus ancrés et ordonnées que durant les siècles précédents. Les inégalités sont alors structurées juridiquement dans le cadre d’un ordonnancement des dignités très précis, reflétant la Société de Cour que Norbert Elias étudie notamment sur le cas de la France. Cet organicisme, toujours teinté de discours religieux, doit expliquer l’état d’un royaume, la santé des peuples… L’essor de l’individualisme et le déclin de l’explication religieuse du monde (P. Hazard, La crise de conscience des sociétés européennes) au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle avec les Lumières génère encore une révolution dans la manière de lire les inégalités et la santé d’un État par rapport aux autres.
2 : Le triomphe des relations internationales :
À l’échelle internationale, les hiérarchies ne sont plus religieuses, ou quasiment plus à partir du XVIIe siècle. L’ordre international ou plutôt interétatique est celui du rapport de forces entre puissances et du droit de la guerre. On voit ainsi se généraliser les alliances entre puissances d’obédience religieuse différente. Louis XIV, pourtant Très Chrétien en son royaume, s’allie avec les Ottomans contre ses ennemis autrichiens subissant la dernière tentative d’expansion sur Vienne dans les années 1680. Le rapport de forces n’est plus religieux, mais il s’appuie sur l’économie, le contrôle des échanges… Des systèmes de régulation des relations inter étatiques sont formulés via les liens dynastiques et via des systèmes d’alliances diplomatiques (système éphémère d’Henri IV parrainé par Sully au début du XVIIe siècle jusqu’à la Sainte-Alliance de 1815, devant réguler et maintenir la hiérarchie des puissances dans le cadre du concert européen après les guerres napoléoniennes et révolutionnaires). À terme, des règles et coutumes de droit interétatique sont mises en place jusqu’à former l’embryon d’un droit international.
Il n’y a plus donc d’inégalités religieuses, l’état d’une société sanitaire et physique n’étant plus expliqué par sa capacité à être bien croyante ou bien guidée par son souverain. Désormais, la société est plus ou moins puissante parce qu’elle est bien productive, qu’elle parvient à échanger, qu’elle s’allie sans considérations de religion…
3 : Le concert des nations et la figure récurrente de « l’homme malade » :
Dans ce cadre les formulations organicistes demeurent, symbole du maintien des anciennes perceptions. Elles associent toujours état sanitaire et physique d’une population à position d’un Etat dans l’ordre interétatique dans le cadre d’un raisonnement mécanique. Les cartes personnifiant chaque pays par son représentant au XVIIe ou au XVIIIe siècle sont éclairantes de ce point de vue, comme si les sociétés n’étaient toujours pas travaillées par des intérêts divergents, des inégalités amenant à des positionnements plus complexes que ceux de la raison d’État incarnée par le Souverain.
r Les caricatures suivant la période du Congrès de Vienne sont patentes.
r L’exemple le plus flagrant est le cas de l’Empire Ottoman au XIXe siècle, désigné comme « l’homme malade » de l’Europe. Systématiquement au XIXe siècle, les Européens lient dégradation de l’état de la population, crétinisme, voire état mental à déclin de l’État et déclin de la place de l’État dans l’ordre international. Les caricatures de l’Ottoman déclinant face à la fierté du grec se libérant du joug impérial est éclairant. Le recul de l’Empire sur la carte européenne est tout aussi patent. Les Ottomans eux-mêmes perçoivent se recul comme une « maladie » de leur État et de leur société. S’opposent alors, un peu comme dans le cas espagnol quelques siècles plus tôt, ceux qui vont chercher la solution dans les vieux schémas englobants religieux (naissance des premières réformes et mouvements islamistes) dès le XVIIIe siècle et ceux qui souhaitent « guérir » par la réforme profonde de l’État. Les discours des sultans ottomans usent ainsi régulièrement du lien entre médecine de l’homme et discours de la réforme pendant la période de tentative de modernisation sur le modèle occidental appelé Tanzimat (années 1840 à 1870).
La rupture moderne provoque donc deux mouvements que l’on peut mettre en parallèle ici : primo le dés encastrement du religieux amène à la fondation de nouvelles théories du droit international où la mondialisation est un processus en plein essor ; secundo, dans cette concurrence nouvelle les métaphores médicales évoluent pour qualifier la place des Etats. Mais peu à peu, c’est bien des nations dont il va être question.
3 : L’état de santé, un indicateur statistique :
À terme, les solutions absolutistes ayant décliné, c’est bien de la santé de la nation dont il faut se soucier pour comprendre la dynamique d’un État dans les relations internationales. Mais les options anti-Lumières, si elles sont détachées du religieux le plus souvent, ne sont pas absentes pour expliquer jusqu’au premier XXe siècle l’inégalité entre l’état de santé des nations. Les nationalismes de puissance semblent avoir définitivement discrédité les vieilles acceptions organicistes, si bien qu’aujourd’hui il ne s’agit plus que d’indicateurs et de chiffres pour positionner telle ou telle nation dans la « société globale » (J. Lévy).
A : De la santé des Etats à la santé des nations et de l’individu :
1 : L’émergence des nations modernes :
La nationalisation du lien politique s’amorce à l’époque moderne, avec le développement des langues imprimées nationales, d’abord officielles, de l’élite avant d’être massifiées. Ce processus s’approfondit avec le XIXe siècle et l’imposition des Etats nations. Dans ce cadre, les Etats territoriaux, monarchies, empires, cités-Etats, deviennent des Etats nationaux selon des procédés et des temporalités divers, avec plus ou moins de réussite (E. Gellner ; AM Thiesse). Ce processus modifie profondément la manière dont les nations vont se percevoir dans le spectre des relations interétatiques désormais, relations internationales.
2 : Massification du lien politique et prise en compte de l’état sanitaire des foules :
Si depuis le XVIe siècle on percevait de plus en plus la « bonne santé » d’une nation dans le cadre interétatique à travers le prisme de l’économie, la place de la santé du Souverain était encore importante. La fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, l’essor de l’individualisme et la révolution industrielle modifient les perspectives.
r L’industrialisation accélère ces préoccupations avec l’accélération de la croissance urbaine. C’est de plus en plus de l’état de la population urbaine dont on s’occupe, puisque c’est bien là que se concentre la population et les problèmes. Les « classes dangereuses », ces paysans prolétarisés, sont d’ailleurs ceux par qui viennent les maladies dans l’esprit du siècle. La ville moderne est propice aux maladies et doit donc d’autant plus être aménagée. Elle doit l’être politiquement, pour éviter les révolutions, mais aussi à proprement parler sur le plan architectural pour réduire les maux du paupérisme (texte d’histoire du XIXe siècle sur la perception de la ville).
La massification du lien politique, modifiant l’équilibre des pouvoirs et corolaire de la nationalisation, engendre donc une nouvelle façon d’évaluer les peuples les uns par rapport aux autres. La sociologie des foules, « l’économie morale de la foule » (E. P. Thompson), cherchent alors à expliquer les mouvements sociaux en partie par la bonne santé, le bien manger, la prise en compte des conditions de vie par le politique… En fait, c’est tout un équilibre symbolique de rétribution – contre-rétribution qui, s’il est cassé, provoque de tels soulèvements (ex : guerre des forêts en Angleterre au XVIIIe s.).
3 : Un exemple de la lecture des inégalités ; hygiénisme et impérialisme :
Depuis la fin du XVIIIe siècle, avant même la révolution industrielle, l’état de santé à proprement parler des populations est pris en compte, particulièrement dans les villes, mais pas seulement, et ce en lien avec les avancées dans le domaine de la médecine et de la préservation de la vie. Les anciennes croyances (théorie des humeurs, très prégnante en France) reculent. Il faut donc de nouvelles méthodes pour améliorer l’état des populations. Les thèses hygiénistes développent ceci. Dans le droit fil du scientisme des Lumières, le rationalisme du XIXe siècle développe les idées d’aménagement urbain, d’organisation du mode de vie, d’assainissement de l’environnement pour améliorer la santé des individus, pour limiter les pestilences… On ne cherche plus à couper ce qui est gangrené comme avec la grande résurgence de peste de Marseille au début du XVIIIe siècle, amenant à la construction d’un mur dans toute la Provence, comme une quarantaine. On cherche à améliorer et empêcher préventivement les épisodes de peste, et surtout au XIXe siècle de choléra. L’étude d’Alain Corbin (Le miasme et la jonquille) illustre bien ce renouvellement de la sensibilité des individus dans lequel la perception de la santé est un point d’évolution essentiel.
À l’extérieur, l’hygiénisme est à relier aux impérialismes. Les sociétés européennes cherchent à s’améliorer à l’intérieur, mais pour mieux refléter l’ordre international inégal qu’elles sont en train d’établir ou de renforcer. En effet, la colonisation doit exprimer une hiérarchie des races (jingoïsme, pangermanisme et Weltpolitik) ou à minima des valeurs d’une civilisation, d’un projet politique (colonialisme français dit universaliste et assimilateur). Les textes (« Fardeau de l’homme blanc ») ou caricatures (montrant que le corps d’un bon français se tient droit, est propre…) inondent les journaux. L’état d’une population jugée supérieure est donc une justification supplémentaire à la colonisation, aux impérialismes. Les chinois sont ainsi dépeints comme les plus dépravés et les corps les plus malades (du pavot, de la mauvaise nutrition…) et donc cibles potentielles pour une amélioration de leurs conditions par la colonisation.
4 : Les réinterprétations modernes de l’organicisme :
À ce stade, on pourrait croire que les vieilles perceptions organicistes pour décrire à la fois l’état de santé d’une population mais aussi de l’État dans l’ordre international sont dépassées. Ce n’est pas le cas. Comme l’identifient Zeev Sternhell (Les anti Lumières) et Antoine Compagnon (les Antimodernes), ces métaphores continuent de guider une part des acteurs du XIXe siècle.
r Les théories racistes modernes émergent et s’appuient sur les observations médicales, sur l’étude du corps, sur les nouvelles méthodes pour essayer de créer un racialisme biologique à la fois réactionnaire et pourtant rationaliste. Ainsi Georges Vacher de Lapouge à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle domine la phrénologie, science de l’étude des cavités du cerveau. À chaque race doit correspondre un type de cerveau dont l’étude permet de prédire les aptitudes politiques, intellectuelles, sociales, culturelles… mais aussi les inaptitudes ou les maladies et les vices. Ce n’est qu’un exemple mais ces interprétations sont légion et importantes alors que les sciences sociales sont en plein structuration.
r Les opposants de la modernité industrielle et nationalistes réactionnaires reprennent ainsi à leur compte ces métaphores et font la jonction entre réaction aux apports des révolutions libérales et à la modernité (perte du lien religieux…) pour expliquer les inégalités internationales comme étant des hiérarchies de races. A la toute fin du XIXe siècle, la jonction est faite entre droite réactionnaire et idées révolutionnaires pour créer les ligues. Elles sont pangermanistes en Allemagne et expliquent que les inégalités raciales déterminent l’existence de peuples de cultures et de peuples de nature (distinction de Friedrich Ratzel) ; elles sont antisémites en France et professent un « nationalisme intégral » (Charles Maurras) ; elles émergent au Japon ou en Angleterre (Chamberlain).
Toutes ces thèses finissent par coaguler et aboutissent à désigner, en la personne des inférieurs de race, les ennemis à abattre. Ce sont souvent les Juifs en Europe de l’Ouest ou encore les Slaves pour les Allemands. Quoiqu’il en soit, ces différentes formulations usent toutes des mêmes métaphores médicales pour demander de soigner des nations censées être parasitées par ces ennemis de race. La France juive d’Edouard Drumont est un exemple ; la géopolitique nazie de Karl Haushofer va dans ce sens.
Extrait de Drumont : à propos des « usuriers juifs » : « Ce qu'il y a de douleurs derrière ce luxe sans raison, absolument bête, est incroyable. Flaubert me disait un jour que c'était nous qui devrions être les médecins de certaines maladies morales, car il n'y a que nous qui les ayons étudiées. Il y a du vrai dans cette opinion. Ce qu'un Parisien sait sans avoir cherché à l'apprendre est inimaginable. Le hasard, à chaque instant, nous montre l'envers de ces existences si brillantes en apparence. Il existe, d'ailleurs, à Paris, cinq ou six prêteuses d'argent, avec lesquelles il suffit de discuter une heure pour connaître à fond le secret de cette société. Hommes et femmes viennent là, écrivent des lettres invraisemblables d'humilité, traitent l'usurière de « chère amie ; » lui prodiguent les douces paroles » (p. 173).
L’ennemi de race est celui par lequel viennent les maladies, il est en soi un parasite, il affecte le corps d’accueil et le rend médiocre jusqu’à le déstructurer et à le détruire, ce corps étant un ensemble organique, comme un être vivant préexistant.
Ces nationalismes de puissance prenant la forme des fascismes et des totalitarismes finissent par complètement disqualifier de radicalité ces manières de penser, ces manières de classer les hommes dans la société politique mais aussi entre sociétés politiques. Le racisme comme réaction à la modernité pour évaluer les inégalités est donc issue des crises mêmes de la modernité. L’après 1945 doit reformuler différemment le classement entre population et sans cesse est suspect par la suite l’attribution de métaphores médicales à des peuples ou des Etats, des nations… Cela le reste encore aujourd’hui.
C : Les inégalités purement rationnelles et la dictature des chiffres :
1 : Les grilles de lectures statistiques :
Désormais, il s’agit bien d’évaluer dans l’ordre international les inégalités, la santé des populations qui sont d’ailleurs reliées par des statistiques et des systèmes de classement de plus en plus complexes, de plus en plus fins. Ce classement ne peut se concevoir d’ailleurs que dans un monde ouvert, mondialisé.
On ne citera pas les grands classements des Etats nations, sans cesse étudiés… On constatera que le calcul de l’IDH prend en compte l’espérance de vie à la naissance et donc l’état de santé d’une population donnée. En effet, les données purement économiques et productivistes sont remises en cause depuis les années 1970 tant par les préoccupations développementalistes que par les questions environnementales. On en vient à calculer non plus la place des nations en termes de pure consommation ou production, mais en termes d’indices plus fins :
r L’IDH, dont une des composantes est l’espérance de vie. Les petits pays nordiques y sont largement valorisés.
r Les indices de développement et de soutenabilité du développement, reléguant les Etats-Unis encore plus loin que le précédent, les maladies liées à la pollution et aux dégradations du mode de vie urbain étant pris en compte (pollution sonore, pollution de l’air…).
r Les civilisations se confrontent alors les unes aux autres et d’extrême Orient les économistes importent l’indice de bonheur national brut, BNB, calculant le degré de bien-être des populations. Il comprend le calcul de la richesse, la soutenabilité du développement économique, mais parmi les 70 critères d’évaluation sont pris en compte la santé mentale de la population, l’état physique de celle-ci, son espérance de vie… Autre élément important, sont pris en compte des statistiques de groupes et pas simplement celles d’individus. Cela encourage donc une évaluation holistique et pas simplement individualiste.
C’est donc un paysage très chargé de critères qui se dégage pour calculer les inégalités entre les nations et les rapports de force, mais globalement, malgré le récent BNB, l’essentiel de ce paysage est composé de chiffres et de calculs rationnels laissant très à l’écart aussi bien les lectures religieuses, holistiques, organicistes ou encore raciales du monde.
2 : Lutter contre les inégalités de santé à l’intérieur pour se classer à l’extérieur :
Parallèlement ces préoccupations développementalistes se traduisent par la recherche de calculs d’inégalités au sein des nations, puisque les points de vue organicistes ne permettent plus de définir un état général de la population à travers un point de vue global, holiste, généraliste. La conscience est claire à propos de l’augmentation des inégalités et de l’échec de l’État social ou Etat-providence qui devait réduire ces inégalités. L’État-providence en crise, les Etats occidentaux et particulièrement européens se rendent compte aujourd’hui, comme le prouve l’étude de Thomas Piketty et même si elle est critiquable, que les inégalités économiques et financières, de patrimoine, sont aujourd’hui aussi importantes que celles qui existaient au sein d’une même société au moment du décollage industriel. L’État redistributeur et allocateur universel de ressources a échoué (T. Piketty, Le capital au XXIe siècle).
Les études se succèdent donc et la question est posée de savoir s’il faut prendre en compte les inégalités internes à une nation pour prendre en compte le classement entre les nations à l’échelle internationale :
r L’étude de Thomas Piketty rappelle ce problème.
r Le calcul du coefficient de Gini est un exemple de ces tentatives de prise en compte des disparités internes de richesses, voire de développement, au sein d’une société.
3 : La santé d’une société à l’épreuve des mémoires et des crises du sens de l’histoire :
Cette dernière question est une forme d’ouverture. Depuis le déclin des grands récits religieux et englobants, on ne peut pas complètement exclure que les sociétés évaluent ou réfléchissent pas simplement sur leur état de santé physique quantifiable, mais aussi sur un état de santé mental qu’il est évidemment plus difficile de cerner. Chez certains auteurs, on parle d’âme des peuples, pour d’autres de génie, pour certains d’une civilisation… Dans tous les cas, c’est d’un malaise psychique, psychologique, d’une crise de conscience, d’un déficit de valeurs dont il est question.
On pourra incarner ce malaise à travers l’exemple viennois de la Vienne 1900, où le plus grand rationalisme, les plus grandes avancées de la civilisation d’alors sont pourtant teintées d’une interrogation sur l’avenir et d’un sentiment mortifère que les historiens nomment le « sentiment fin de siècle ». Il se traduit par une inquiétude sur l’avenir, un pessimisme, une ironie et un détachement qui confinent à la dépression, ce qu’on appelle neurasthénie alors. Ce malaise toucherait la société et serait exprimé notamment dans les arts. Ainsi Klimt, Kokoschka ou Schiele dont les œuvres sont autant brillantes qu’inquiétantes (« La mort et les morts » de Klimt) mais aussi l’étude des rêves de Freud seraient des manifestations de ce malaise mental d’une population. Celui-ci se traduit par les morts prématurées des héros esthétiques, tous emportés par la tuberculose, la syphilis ou d’autres maladies infâmantes comme si l’élan créatif essoufflait l’élan vital (Jacques Le Rider). D’ailleurs pour beaucoup, rétrospectivement, l’inquiétude était bien fondée, la belle société cosmopolite viennoise, cette Cacanie dont Robert Musil parlait (L’homme sans qualités) devant s’effondrer avec la Première Guerre et s’enfoncer dans l’obscurantisme le plus évident avec les années 1930…
Plus récemment, certains qualifient de malaise dans la civilisation française ou de déclinisme en France aujourd’hui l’état de la société actuelle. Cette perte de valeurs, de confiance, d’identité qui aboutirait à un déclassement de la France et d’une perte de santé mentale (la France est l’un des premiers consommateurs d’antidépresseurs au monde, et est régulièrement classée première parmi les pays pessimistes sur l’avenir, devant des pays en guerre civile chronique !) devient une véritable veine pessimiste dans l’écriture et la pensée, reprenant allègrement parmi les thèmes des antimodernes, sinon des réactionnaires évoqués précédemment (Alain Finkielkraut, L’identité malheureuse, Eric Zemmour, Mélancolie française ; l’œuvre de M. Houellebecq…). Tous les deux considèrent le déclin français comme étant un malaise de la civilisation française dont l’une des manifestations serait le développement d’une crise psychologique profonde, à même d’accélérer le déclassement français. Et vient désormais le complexe du « grand remplacement », par la question migratoire…
ISD - Paris
Institut Saint Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97 - 09.50.18.63.99
Autres campus :
ISD - Alpes (été / hiver)
ISD - Bourges (automne / été)
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2025 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
Satisfaction (année 2024-2025) :
Satisfaction certifiée auprès des répondants (inscrits élèves, étudiants, auditeurs libres) - Cliquer pour vérifier !
4,1/5