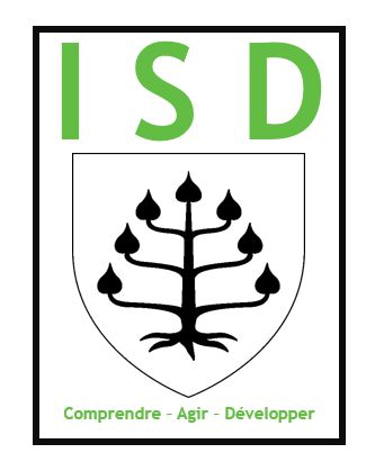Pour une meilleure expérience, privilégiez une visite sur notre site internet avant une version mobile remaniée !
URGENT : PRIVILEGIER UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR MAIL POUR TOUT RAPPEL
La fausse transition du sous-sol du capitalisme de C. Izoard
Compte-rendu de l'ouvrage de Célia Izoard (La ruée minière au XXIe siècle, Seuil, 2024) sur la mine lieu-clé du capitalisme autophage et d'une transition qu'elle veut redéfinir
RELATIONS INTERNATIONALES - GÉOPOLITIQUEGÉOGRAPHIEECONOMIEECOLES DE COMMERCECULTURE GÉNÉRALE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ECOLES D'INGÉNIEUR ET SCIENCES DITES DURES HUMANITÉS ENVIRONNEMENTALES
Franck Jacquet
7/7/202410 min lire
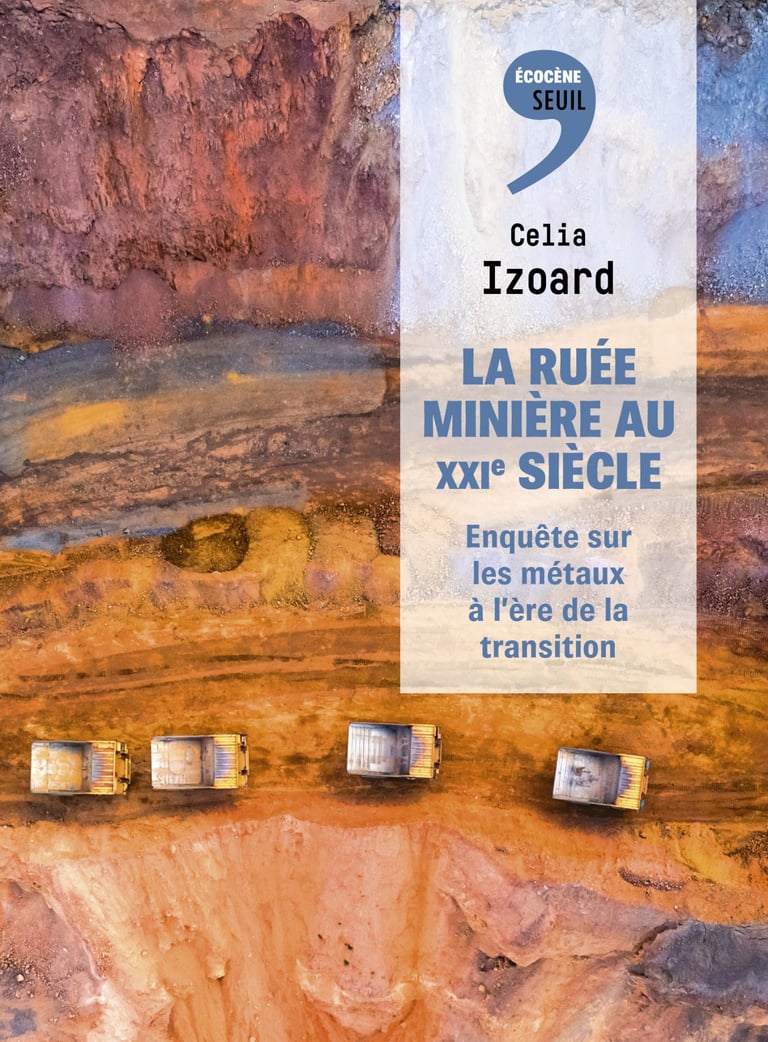
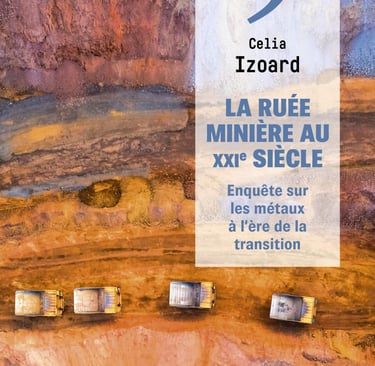
La Banque mondiale, cite elle-même l’autrice, assène dans un rapport portant sur le rôle des minéraux dans le « Low-carbon Future » (en 2017), que « les technologies qui pourraient permettre le passage à une énergie propre s’avèrent en réalité PLUS intensives en matériaux dans leur composition que les systèmes actuels fondés sur les énergies fossiles. (…) Pour le dire simplement, un avenir fondé sur les technologies vertes exige beaucoup de matières premières qui, si elles ne sont pas correctement gérées, pourraient empêcher les pays producteurs d’atteindre leurs objectifs en matière de climat et de développement durable » (p. 61). Ces quelques lignes pourtant établies par l’un des anciens cœurs institutionnels du système-monde libéral (son ordo-libéralisme a tout de même été relâché depuis les années 1990-2000, rappelons-le, ce n’est pas inutile ici) posent simplement mais clairement le propos de l’ouvrage : ce qu’on nomme transition, en prenant en compte les énergies actuelles et le mode d’extraction par le capitalisme minier, libéral, n’a aucune chance de mener aux objectifs affichés de la COP 21 ou ne peuvent que démentir les récents bons résultats de la France qui annonce en juin 2024 une baisse des émissions en accord avec la trajectoire définie par ses engagements internationaux. Non, décidément, non, ce n’est qu’un jeu comptable qui, par l’externalisation des destructions minières, permet à la France de commencer à établir son secteur des batteries automobiles (devant participer de la réindustrialisation des Hauts-de-France notamment) en affichant de bons chiffres, sans tenir compte de l’extraction des matériaux et terres rares qui génèrent une véritable « intoxication globale » de l’espace-monde.

Les sous-sols, la mine comme soubassement
Incontestablement, la première partie de l’ouvrage permet au non connaisseur de se mettre à jour sur la question, et ce avec une grande pédagogie. Tous les aspects du système productif d’extraction minier sont expliqués avec clarté : qui ? quand ? comment ? pourquoi ?...
C’est aussi un constat sans appel qui est exposé dès le départ : les mines minent (sic !) les paysages, les milieux mais aussi les sociétés, et ce parfois depuis l’antiquité. Une très belle étude de cas autour de Rio Tinto et de l’Andalousie, dont une partie est devenue, pour produire du cuivre par une monstruosité d’énergies dilapidées, un paysage mort, proche de Mars, rouge, gris, sans vie ou presque. Cette étude est filée durant toute la première partie de l’ouvrage et pourra faire le plaisir des géographes. Certains objecteront peut-être d’ailleurs que jamais la question démographique, et donc du volume réel à venir de la demande, n’est prise en compte, alors que bien des démographes annoncent un « hiver démographique » mondial bien plus rapide que prévu.
Tout de suite est rayée l’hypothèse de la durabilité forte et le constat, chiffres à l’appui, est sans appel : primo, il n’y a pas assez de matériaux utilisés par la transition pour mener celle-ci, secundo on pollue plus et pas moins avec ces mines qui sont gourmandes en énergies (la « mine responsable n’existe pas, même si on la relocalise) et tertio, toujours avec une grande richesse d’exemples, cette mine génératrice de pollution ne peut que nuire aux communautés humaines sans efficacité économique prouvée. On citera un cas parmi les nombreuses illustrations : à Mount Isa (Australie), une fonderie de plomb et de cuivre détruit la lithosphère et la biosphère sur un espace estimé à au moins 100.000km2 (p. 43). Un constat donc sans appel !
Une démarche classique : la revisite des mythes fondateurs et de la trajectoire occidentale par le prisme de la mine
Parfois, à prendre un peu de recul, on est gêné. Aucune place pour la prise de recul. La mine colle PARFAITEMENT à la civilisation européenne et plus généralement occidentale, capitaliste et progressivement libérale. Comme bien des essais de sciences humaines et sociales publiés depuis une décennie, une bonne moitié de l’ouvrage (surtout la seconde moitié, composée des deux dernières parties) fait de son objet (ici la mine), une synecdoque de l’européanité moderne, si on prend l’expression de la géohistoire d’un F. Braudel ou selon le terme d’un J. Lévy. Un recul critique, des nuances, des contradictions ou même des réflexions sur le degré de conscientisation des acteurs seraient de bon aloi…
Le déterminisme est assez présent donc dans le propos. L’Occident est fondé sur le prométhéisme, l’idée de transformation de la nature, effectivement. Si les racines sont anciennes, grecques, c’est avec la rupture de la modernité aux XVe – XVIIe siècles que la mine devient cet ogre dévoreur d’espaces. Mais l’autrice est attachée à revenir à l’antiquité de cette histoire de la mine : il s’agit du mythe d’Erysichthon, puni d’absence de satiété par Déméter d’avoir détruit ses bois sacrés pour s’ériger un palais. Il reflète déjà le capitalisme autophage… Une fois la « cosmologie extractiviste » européenne établie, les étapes s’enchaînent alors rapidement, presque mécaniquement ?
La civilisation européenne extractiviste a un cœur, ses mythes, depuis les Grecs donc, mais surtout avec le triomphe de l’homo faber si cher à Bergson ou Arendt : c’est quelque-part le héro fondateur dont il s’agit
Le géosymbole incontestable est le Potosi, cette partie bolivienne d’un tout, l’Amérique, dont l’Europe suce les sous-sols dès la conquête jusqu’à rendre les reliefs méconnaissables
Au XVIe siècle, la bourgeoisie ne se contente plus d’être un intermédiaire mais achète les matériaux et bientôt les mines elles-mêmes pour les faire entrer pleinement dans l’âge capitaliste, le précurseur étant pour ce faire Jacob Fugger, pater familias de la dynastie des banquiers fournisseurs clés de la dynastie habsbourgeoise
La mine devenue capitaliste, c’est la guerre : depuis le « siècle de fer » jusqu’au raccourci assez rapide de la « guerre civile » suggérée avec les Gilets jaunes ! (p. 285), cela ne se démentirait pas…
Parallèlement Hartlib, Bacon et les autres grands de la révolution scientifique qui s’établit depuis l’Angleterre (les Pays-Bas sont ici laissés de côté) au XVIe siècle, font de la Terre un ensemble d’éléments qu’il est logique de transformer pour améliorer les conditions de l’Humanité : ici, on mettra en avant combien la question religieuse (les dissenters, levellers…) ont au fond un rôle important pour faire « dévier » une partie du cours de cette révolution scientifique !
Marxisme, quand tu nous tiens… : la bourgeoisie détenant les mines s’appuie sur la guerre et la dépossession des masses pour entretenir son pouvoir…
Marxisme, quand tu nous tiens… (bis) : … et s’il y a des rébellions sociales, alors la bourgeoisie défend son appropriation du sous-sol par le droit, arme de répression massive !
(Néo)-Marxisme, quand tu nous tiens… (ter) : c’est même tout l’ordre mondial qui est reflété par la possession ou non des technologies et des sous-sols à extraire. On peut penser à I. Wallerstein et son histoire du système-monde capitaliste. L’histoire de la mine comme objet matériel de domination s’y insère parfaitement (d’abord les grandes industries européennes, puis désormais les grands conglomérats chinois, d’autres grands investisseurs américains qui résistent à ces derniers, comme le Canada par exemple…). L’évolution du commerce international et la DIPP ne font que polluer toujours plus pour des gisements toujours moins porteurs !
La décroissance et la fin du capitalisme sont donc la suite et fin logique du raisonnement, qu’on peut anticiper dès les premières pages…
Enfin, et c’est une prise de position majeure de l’essai, si les tenants du capitalisme extractiviste libéral sont attaqués, comme ils le sont pas la question du changement climatique, ils détournent cette nouvelle notion (et la superstructure qui va avec) pour conserver son pouvoir, d’où le fait qu’on accélère dans l’extractivisme, mais qu’on (semble) croire que ce qu’on extrait désormais est amené à solutionner l’extractivisme lui-même : le charbon ou le gaz remplacés par le lithium serait la solution, mais on a vu qu’il s’agit ici largement d’un mythe…
Le constat va alors dans la même direction que le propos d’A. Malm : la mine responsable n’existe pas, et donc quelques-uns sont amenés à posséder tout alors qu’ils dérobent le sous-sols des masses qui n’ont rien et qui sont plus vulnérables aux effets du changement climatique… (le stress hydrique en Andalousie est un bel exemple employé par l’autrice). C’est tout juste s’il ne faut pas saboter, dès lors les mines, puisque le chemin de règlement majeur évoque en fin d’ouvrage, du point de vue politique, est la démocratie. Ainsi, à 23h45 avant le Minuit de la révolution globale qu’A. Malm appelle désormais de ses vœux, LE politique peut tout déjouer !
Une enquête riche
Le travail, s’il peut inquiéter par le manque de réflexion sur la pluricausalité et s’il semble sans nuances, est extrêmement utile pour bien des aspects :
Pour les économistes ou ceux qui s’intéressent aux grands enjeux contemporains, la seconde partie témoigne secteur économique après secteur économique, un système productif après l’autre (aérospatiale, smartphone, technologies du quotidien…), que l’intensité des métaux est bien plus grande aujourd’hui qu’auparavant, et que le sens de « transition » est bien souvent dès lors mal utilisé, puisqu’au fond on ne remplace pas une source d’énergie par une autre, mais on accumule les sources d’énergie pour puiser toujours plus : du bois sert toujours pour extraire le pétrole ou le gaz et l’eau, le bois ou les hydrocarbures sont utilisées dans les « mines durables » qui extraient des matériaux tels le lithium, le béryllium. D’ailleurs, « la nouvelle économie » n’était qu’illusion : tout cela a toujours reposé sur « la matière », qui reste invaincue et nécessaire (p. 200) malgré ce que les mythes de la société de l’information et des services ont pu essayer de faire croire.
Toujours du point de vue des systèmes productifs, au fond, si on utilise toujours plus d’énergie pour extraire d’abord de mines, puis de mines à plus faible rendement, puis des montagnes de déchets des mines avec des procédés pour récupérer le peu du peu, c’est d’une histoire de « détour de production » dont il s’agit ! Les économistes de Vienne l’avaient vu.
D’un point de vue « philosophique », anthropologique, l’européen, rappelle Célia Izoard, est décrit comme un « mangeur de terre » par les Amérindiens très tôt, qui s’étonnent de voir leur insatiable de retournement des sols pour en extraire des métaux en toujours plus petite quantité… A terme, l’habitabilité et l’expérience de l’habiter dans son acception phénoménologique sont comme engloutis a priori par la mine capitaliste comme il en serait de même pour la grande plantation… Dès lors, quel sens prend le sens d’habiter un milieu caractérisé par un paysage de l’engloutissement et du retournement des sols dès lors moins vivables ?
L’histoire des sciences est reposée ici sous un angle intéressant d’un certain point de vue : plutôt de voir la révolution scientifique comme le triomphe de la rationalité occidentale appuyée sur l’expérience, l’autrice remonte aux paradigmes de base du cheminement technologique et intellectuel qui fait qu’au fond, le système technique qu’est l’industrialisation est une figure de la maîtrise de la Nature par l’Homme : mais qu’y a-t-il de rationnel (au moins dans une rationalité processuelle) à penser que ce dernier doit disposer nécessairement de la première ?
Pour la géographie politique, il s’agit de traiter de la question d’une forme de pouvoir, « le régime minier », défini comme « un type de pouvoir fondé sur l’exploitation des sous-sols qui a été instauré par la bourgeoisie et sur lequel elle s’est appuyée pour dominer l’organisation sociale. Il est la traduction d’(une) cosmologie extractiviste, d’une vision du monde tendue vers la quête mystique d’un paradis dont le sous-sol recèlerait les clés (du paradis) » (p. 265-266). C’est au fond même une question de nature théologico-politique qui est posée par cette définition, qu’on pourrait rendre plus applicable en bien des points en se « débarrassant » d’un certain vocabulaire marxisant
Toujours sur le plan politique, le régime démocratique étant la solution, on se pose l’applicabilité de la solution prônée d’un point de vue conjoncturel quand on observe la crise de ce système institutionnel et de ses valeurs, en Occident comme ailleurs. Sur un plan plus structurel, s’extraire de la logique du système capitaliste minier doit aussi passer d’une part par la réflexion purement économique sur la décroissance marginale des puits et lieux exploités (d’où la question des Communs, sous les projecteurs) et d’autre part par la revalorisation des logiques de l’action, dit autrement, par l’économie morale et une autre manière de comptabiliser les coûts de l’exploitation minière. Si on se questionne sur la transition, les lignes ci-dessus déjà témoignent d’un certain retournement de la question telle qu’elle est généralement posée. Mais, et c’est l’apport de la dernière partie, Célia Izoard démine (sic !) les fausses questions ou fausses bonnes idées (le recyclage, continuer à miter le sous-sol global, chercher dans les villes ou amalgamer et piocher dans les restes…) car toujours, on en revient aux effets polluants de quelque forme de recyclage que ce soit. Les vraies bonnes questions sont dès lors liées à la manière de poser une décroissance et une « désintoxication » vis-à-vis des métaux de nos sociétés. C’est le cadre incontournable qui est posé (aux critiques de nuancer sur un point ou un autre… ?). Et puisque l’économisme a mené à cette impasse, c’est au politique qu’il faut confier la solution, sans nécessairement passer par la révolution, mais en créant d’une part de nouvelles solidarités (p. 288-290) qui semblent mener tout droit cependant à l’impasse NIMBY si on prolonge le raisonnement mené, et d’autre part en passant par le régime et les valeurs démocratiques comme solution à la soif du sous-sol.
Pour l’ingénieur, une question éthique est posée en toute fin d’essai : c’est pour l’autrice l’acteur-clé qui peut se détacher du système extractiviste pour cesser de vouloir l’améliorer ou de convenir de le soutenir de par ses compétences. Avis aux futurs ingénieurs !
L’exemple des référendums locaux en Amérique du Sud (p. 284) met en avant que l’homme d’ailleurs encore imprégné de mythes non extractivistes (entendons par là non européens) peut dire non à la dévastation du sous-sol, en l’occurrence par des référendums. Malgré certains « raccourcis », ou un manque de nuances, la mine (et d’autres l’ont fait avec l’économie de plantation) est une pierre de touche pour penser bien des questions qu’il convient aujourd’hui de mettre au-devant de la scène, et qui demeurent comme nos sous-sols, sous-jacentes dans le débat public !
Vidéo complémentaire avec Célia Izoard - Source : Blast
ISD - Paris
Institut Saint Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97 - 09.50.18.63.99
Autres campus :
ISD - Alpes (été / hiver)
ISD - Bourges (automne / été)
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2025 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
Satisfaction (année 2024-2025) :
Satisfaction certifiée auprès des répondants (inscrits élèves, étudiants, auditeurs libres) - Cliquer pour vérifier !
4,1/5