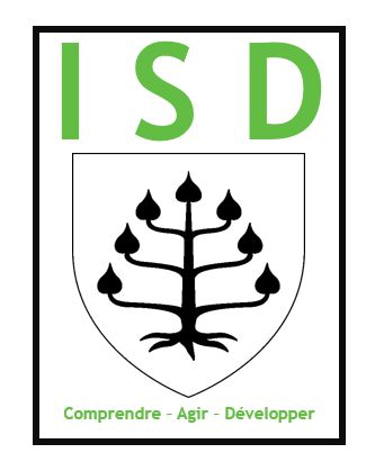Pour une meilleure expérience, privilégiez une visite sur notre site internet avant une version mobile remaniée !
URGENT : PRIVILEGIER UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR MAIL POUR TOUT RAPPEL
La "bonne gouvernance" ; la fin de trois décennies d'un mirage
Il y a 30 et cet esprit commence à s'estomper chez les décideurs comme dans les opinions publiques, la "bonne gouvernance" semble être un horizon commun qui peut permettre d'organiser les intérêts de tous en harmonie... Il est remarquable de voir comment les piliers e cette vision du monde, selon Georges A. Le Bel, se dissipent seulement désormais, avec le fracas russe mais qui n'est qu'un exemple parmi les failles du système international. A son émergence, une idéologie de la non-idéologie qui s'effondre désormais malgré l'adaptation des règles du FMI, de la BM...
ECOLES D'INGÉNIEUR ET SCIENCES DITES DURES RELATIONS INTERNATIONALES - GÉOPOLITIQUEIEPSCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ACTUALITÉS ECOLES DE COMMERCESCIENCES SOCIALES ET MORALESSCIENCES POMONDIALISATION
GEORGES LE BEL
5/9/202513 min lire


La Banque mondiale est devenue un haut lieu de définition politique des paramètres idéologiques, disputant ainsi la place jadis occupée par l’OCDE. On y invente maintenant des concepts et des programmes qui font le tour du monde parce que l’incidence de la Banque lui permet d’imposer son discours aux décideurs publics. Ce rôle s’est grandement accru avec la crise de la dette lorsque les pays de l’OCDE ont décidé que les débiteurs devaient s’imposer des réformes. Ceux-ci utilisent la Banque mondiale et le Fonds Monétaire international où ils ont la majorité des votes, comme gendarmes des consortiums bancaires pour que les dettes soient payées. Ce fut la politique des années quatre-vingt, dites des ajustements structurels. On en connaît la critique et les effets : dépression économique, diminution des revenus nationaux, chômage, destruction des services et infrastructures publics, paupérisation. Dès la fin des années quatre-vingt, la Banque réajustait son tir et proposait comme services essentiels au développement à long terme, le maintien de l’éducation et de la santé, et la protection des groupes sociaux les plus vulnérables. L’implosion des économies et des États de l’Est européen fournissait l’occasion de repenser tout cela. On fusionna alors le « Reform Kit » des ajustements structurels imposé au Sud depuis dix ans avec le discours triomphaliste de la guerre froide. C’est ce qu’on a appelé le « Consensus de Washington » dont sortira le modèle de réformes institutionnelles et d’économie de marché qui sera présenté aux économies est-européennes en 1990 et que l’on retrouve dans le texte de la Constitution de la BERD. (...)
Le Good Governance est maintenant sur toutes les lèvres. C’est le principal thème de propagande du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l’UNICEF. C’est aussi celui du projet de réforme des politiques sociales au Canada de M. Axworthy, dont les documents préparatoires portent sur les thèmes suivants : « travail, éducation, politique sociale et gouvernance ». C’est le discours de M. Marcel Massé qui devient en français « Pour un bon gouvernement ». Finalement, c’était le thème d’un document du Forum des politiques publiques en juin 1993. On ne peut traduire pas ce mot clef du jargon international. Avec plusieurs autres, il vient de Washington et traduit l’« agenda » de la « mondialisation » ou de la « globalisation » avec des termes comme ajustements structurels à visage humain, ce qui doit tenir compte des conditions sociales au Sud, et qui au Nord, s’appelle : réduction du déficit et du rôle de l’État, déréglementation, privatisation, sous-traitance, impartition et révision des programmes sociaux. Le political correctness internationale comprend une série de mots clefs essentiels : Empowerment, Self-reliance ; donner un rôle aux femmes, Place à la « Société civile », Basic needs et Sustainable Development. (...) Nous proposons d’examiner à quels impératifs juridiques répond cette nouvelle poussée idéologique que nous essayerons ensuite de définir plus précisément avant de conclure sur une critique sommaire.
Pourquoi ce discours, et d’où vient-il ?
Pour bien comprendre l’enjeu de ce discours, il faut en connaître les conditions de création, les textes des institutions de Bretton Woods et leur relative inadéquation au contexte mondial actuel qui n’est plus celui d’il y a cinquante ans et de la reconstruction d’après-guerre. On se souviendra, et d’autres textes l’explicitent largement, des débats de la Conférence monétaire et financière autour des Nations Unies de 1944. Deux points sont aujourd’hui pertinents pour nous : la liaison de la Banque à l’Organisation des Nations Unies et son rapport aux politiques étatiques. Des nombreuses études ont opposé la vision de Lord Keynes à celle des États-Unis d’Amérique. Lord Keynes souhaitait que la Banque mondiale et le FMI soient deux organismes autonomes et techniques séparées des vicissitudes des politiques nationales, un peu comme une banque centrale internationale. Les Américains eux les voulaient soumis à un contrôle serré des gouvernements nationaux, et bien sûr d’abord au leur 8. Les États-Unis ont insisté pour que les institutions de Bretton Woods ne soient pas directement reliées au système des Nations Unies. Ils ont eu gain de cause sur ce point. La Banque mondiale est une agence spécialisée indépendante du système des Nations-Unies. Son siège est à Washington pour bien montrer la distance d’avec l’institution de New York et peut-être la proximité avec le gouvernement dont c’est le siège. La Constitution de la Banque est claire à cet effet et l’entente de 1947 qui lie la Banque et les Nations Unies est explicite : La Banque est une agence spécialisée au sens de l’article 57 de la Charte des Nations-Unies, établie par entente entre ses gouvernements membres, ayant de larges responsabilités internationales définies par son accord constitutif, dans les domaines économiques et connexes. En raison de la nature de ses responsabilités internationales, la Banque est, et doit fonctionner comme une institution indépendante".
La seule exigence contenue à cette entente est que la Banque mondiale est tenue de conduire ses activités « with due regard », c’est-à-dire, « en tenant compte des décisions du Conseil de Sécurité qui excipent des articles 41 et 42 de la Charte » concernant le maintien de la paix et la sécurité collective... Bref, en tenant compte des sanctions économiques qui y sont adoptées. Cela est si vrai que, malgré une demande formelle de l’Assemblée générale, la Banque ne se présente toujours pas au Conseil économique et social pour y défendre son rapport annuel et ses politiques comme le suggérerait pourtant l’article 60 de la Charte des Nations Unies. L’autre point de divergence de 1947 portait sur la dimension politique des décisions de la Banque. Soucieuse de rassurer les Soviétiques, la délégation britannique avait proposé d’inclure l’article suivant dans la Charte du Fonds monétaire international : "The Bank and its officers shall not interfère in the political affairs of any member ; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the membre or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and these considérations shall be weighed impartially in order to achieve the purpose stated in Article I". C’est là le texte actuel de l’article IV § 10 de la Banque et de l’ADI.
Après négociations, cette disposition se trouvera dans tous les autres textes constitutifs de la Banque sauf dans celui du FMI 10. Cette disposition est renforcée par celle de l’article III § 5 (b) (BIRD) interdisant spécifiquement à la Banque dans son processus décisionnel de prendre en compte des considérations politiques ou de quelqu’autres influences non économiques « , mais l’obligeant à n’envisager que « des considérations économiques et d’efficacité ». L’article V § 5 (c) précise que les officiers et personnels de la Banque dépendent d’elle et d’aucune autre autorité et que « chaque État membre doit respecter le caractère international de cette fonction et s’abstenir de toute tentative d’influence dans l’exécution de leurs fonctions ». On se souviendra en effet de la campagne pour le respect des droits de la personne du président Carter des États-Unis. Au début des années quatre-vingt, une loi américaine impose à tous les fonctionnaires américains agissants dans les organisations internationales, et donc au Directeur exécutif américain de la Banque qui est ex officio son président, de s’opposer à tout prêt ou assistance financière ou technique à tout pays qui viole grossièrement les droits de la personne, à moins que le programme ne soit orienté à la satisfaction de « besoins de base » (basic needs) des populations. Quand on sait le poids politique et institutionnel des États-Unis à la Banque mondiale, cela ne pouvait pas ne pas avoir d’effets. Les juristes se mirent à l’œuvre pour réinterpréter la Constitution de la Banque afin de rencontrer les exigences américaines. Déjà la question des prêts à l’Afrique du Sud et au Portugal avait posé le problème du respect par la Banque mondiale des sanctions imposées par le Conseil de Sécurité, mais c’était encore un problème théorique puisque trois des membres permanents du Conseil possédaient la majorité de blocages à la Banque mondiale. La question se posa avec plus d’acuité à partir du moment où les groupes internationaux de pression ont réussi à rendre politiquement intenable la position de la Banque non plus seulement en ce qui concerne les droits de la personne, mais aussi les questions d’environnement. La Banque a alors eu recours au détour suivant : « Good ecology is good economics ».
La Banque développa l’argumentation suivante : les documents constitutifs « excluent les considérations politiques ou autres que purement économiques » ; mais la Banque a le devoir de s’assurer que le pays emprunteur est structurellement à même (compètent) de dépenser les fonds de la Banque de manière efficace et productive. Cela signifie que la Banque peut non seulement exiger les ajustements structurels macro-économiques et financiers, mais encore des restructurations sectorielles, des réformes politiques, l’amélioration de l’efficacité et de l’administration du secteur public. C’est ce que la Banque a appelé la « question de la liaison » (linkage issue). Bien sûr, la Banque et ses agents ne peuvent intervenir dans les affaires politiques de ses membres, mais « des événements politiques internes ou externes peuvent avoir des effets économiques directs et importants ». La Banque ne doit pas permettre que des considérations politiques interviennent dans ses décisions « à moins qu’elles n’aient un effet économique direct et évident » (...) « comme les impératifs de l’ordre public, d’un climat favorable aux investissements et d’une utilisation efficace des ressources ». (...)
Voyons donc ce qui est inclus sous ce concept de Good Governance qu’il nous semblerait impropre de traduire comme le fait M. le Ministre Marcel Massé par Good Government, car ce terme, qui figure à la Constitution du Canada depuis 1867 comme fondement de la juridiction du gouvernement central canadien, pourrait alors servir de base à toutes les prétentions centralisatrices fédérales.
Good Governance
On cherche en vain dans les documents internationaux une définition précise et limitative de ce concept mou dont la flexibilité est une condition d’utilité dans des contextes nationaux très divers et qui sert à recouvrir des conditionnalités très variées. La base du good gouvernance est un « amalgame savant d’institutions, de lois, de procédures et de normes, permettant aux gens d’exprimer leurs préoccupations et de défendre leurs intérêts dans un contexte prévisible et relativement équitable » . Le terme est apparu pour la première fois dans le 1989-Long- Term-Perspective-Study (LTPS) : Sub-Sahara Africa : From Crisis to Sustainable Growth qui concluait « underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance » (p. 60) reflétée par l’absence de Rule of Law et de système judiciaire efficace et indépendant. Ce document proposait qu’aucune aide ne soit accordée sans une nette amélioration de la gouvernance qui passe par celle de l’« imputabilité » (accountability) des dirigeants envers leur peuple, de la transparence dans les transactions, l’administration des fonds publics et l’attribution des contrats, par le respect des procédures établies (due process), par la déréglementation et par une réforme de la fonction publique. Il ajoutait qu’un cadre légal transparent et correctement mis en œuvre est indispensable au succès durable d’une entreprise. Et pour conclure, des efforts systématiques devaient être entrepris pour construire une structure institutionnelle pluraliste qui respecte le Rule of law et une protection vigoureuse de la liberté de la presse et des droits de l’homme (p. 61). (...)
Les insuffisances et contradictions du Governance
Le premier élément boiteux de cette théorie c’est qu’elle postule comme existant un équilibre qu’elle a, par ailleurs, pour objectif de produire. En effet, pour le développement d’un environnement efficace au marché, cette théorie implique l’existence et la persistance d’investissements renouvelés dans les gens et les infrastructures, alors que la maximisation de l’efficacité du marché implique l’exclusion des plus faibles et des inaptes. C’est le principe du modèle que les plus faibles vont échouer et seront éliminés du système. Comment alors prétendre assurer la participation démocratique à un pareil mécanisme d'exclusion ? La contradiction est encore plus flagrante lorsqu’il s’agit non plus des individus, mais des économies des États. La compétition a des effets darwiniens terribles sur et dans les pays les plus faibles ; c’est-à-dire précisément ceux qui manquent de financement, d’investissement et d’épargne, de compétence et de technologie, d’informations ou d’expérience. Or c’est le cas de la majorité des pays en voie de sous-développement que prétend « aider » la Banque mondiale. Ces pays doivent échouer parce que, comme le veut la théorie du marché, leur efficacité économique est évidemment moindre. Tout ce que garantit le modèle, c’est que le marché offre aux compétiteurs la même situation et les mêmes garanties que le Rule of Law offre aux parties dans un procès : un terrain de lutte égal pour des parties inégales (le fameux « level playing field » des libre-échangistes).
En ce qui concerne les pays du Sud, il n’y a pas d’exemple où ce modèle a fonctionné. Les nouveaux pays industrialisés (NPI ou, en anglais NIC : Newly Industrialised Countries) le doivent à d’autres conditions. On sait statistiquement que ça ne marchera pas ; que les pays les moins développés ne croîtront pas ni ne recevront d’investissements qui continueront de diminuer pour eux. Comment alors ne pas considérer comme incohérente une politique du développement qui valide la marginalisation politique et économique des plus pauvres et des plus vulnérables dans la société et la communauté des nations ? Mais ce serait lui faire insulte que de prétendre que la Banque mondiale ne s’en est pas rendu compte. Et elle s’est lancé depuis dans une vaste offensive mondiale « d’ajustement » idéologique qui est sa campagne actuelle de « réduction de la pauvreté. » Les riches insisteront sur la réduction de la pauvreté. La Banque mondiale, le Sommet mondial des Nations-Unies pour le Développement social (Copenhague 1995) et les nombreuses conférences internationales se pencheront avec compassion sur les cas d’extrême pauvreté.
En effet, pour que le « cercle vertueux » puisse se réaliser, il est nécessaire que la société civile y participe ; et une condition essentielle de sa participation est précisément que ce système résolve ou masque les conséquences les plus criantes de sa mise en place. D’où l’actuel glissement du discours qui ne porte plus sur les « droits » économiques, sociaux et culturels, mais déplace l’attention vers la satisfaction des basic needs ; les besoins primaires dont l’État minimal devrait assurer la satisfaction. Comme si nos droits fondamentaux étaient respectés dès lors que l’on a une pièce de tissu pour se vêtir et se loger et un minimum de calories. Il faut bien voir que ce discours sur les basic needs n’a qu’un objectif : dégager les États du Nord de toute obligation en ce qui concerne les droits économiques et sociaux de leurs propres populations en concentrant l’attention sur les cas d’extrême pauvreté dont la prise en compte dédouanerait l’État de toute autre responsabilité. Ce discours ignore et nie la progressivité affirmée et nécessaire dans la réalisation des droits économiques et sociaux. Mais même si l’on accepte que l’État puisse se désintéresser de ceux qui par divers expédient et combines, réussiront à s’en sortir plus ou moins, ce discours sur l’extrême pauvreté comporte une autre contradiction, surtout en ce qui concerne la problématique de l’aide au développement qui est la principale fonction de la Banque. Celle-ci selon la théorie du Good Governance conditionnera ses prêts à la réalisation de certains facteurs sociaux du développement ; protection des structures sociales et des cultures, respect des droits, transmission des valeurs, besoins des femmes et des minorités ethniques, mesures pour la santé et l’éducation, encouragement de la société civile qui sont autant de déterminants essentiels de la stabilité sociale dont l’écroulement génère des urgences immensément destructrices et très coûteuses à gérer : Haïti, Rwanda, Yougoslavie...
Mais il y a là une contradiction pour l’aide au développement : si l’aide vise surtout le soulagement de la pauvreté, cela nécessite le maintien des conditionnalités, la promotion des droits et de la démocratie, centrale au Good Governance. Or ces violations sont le plus susceptibles d’intervenir dans les sociétés où les institutions civiles sont les moins fortes, c’est-à-dire dans les pays les plus pauvres. La théorie postule alors que l’on retirera l’aide aux pauvres qui ne respectent pas les conditions.... Précisément parce que leur condition d’extrême pauvreté les empêche de les respecter, de la même façon que l’on retire la protection sociale à un chômeur qui n’est pas capable de faire la preuve qu’il peut se trouver un emploi. La théorie du Good gouvernance et des conditionnalités fondées sur la démocratie, le Rule of Law et le respect des droits peut fournir à nos États du Nord qui cherchent des dépenses à couper, de bons motifs pour se retirer ou réduire l’aide aux pays les plus pauvres. Les démocrates, y compris de nombreux politiciens sincères des pays riches et la société civile le demandent déjà comme sanction des violations des droits fondamentaux, alors que dans les faits cela permet d’intervenir indirectement auprès d’un gouvernement alors que l’intervention directe est impossible.
Ce discours qui conditionne l’aide au respect des règles de « governance » est donc profondément contradictoire puisqu’il permet au nom du développement de disculper et d’absoudre notre refus de participer au sauvetage d’un nombre de plus en plus élevé de pays qui sont écartés et marginalisés dans ce monde proclamé global. Ce n’est pas le moindre paradoxe de ce discours sur la mondialisation et la globalisation que d’en taire l’effet le plus patent qui est la dualisation non plus seulement de nos sociétés occidentales, mais la transposition de ce modèle dual au niveau global. La mondialisation est un mythe dont les trois quarts de la population du globe sont exclus. La globalisation est une politique destructrice au service de certains États et non pas un fait propre à une économie internationale autonome qui se seraient affranchis de la tutelle des États empêtrés dans leurs problèmes de dettes. Sur ces bases, la participation de la société civile et les diverses consultations populaires apparaissent non pas comme la construction d’un « partenariat nouveau », mais comme l’entérinement des conditions imposées de l’extérieur, et à la réduction des droits économiques et sociaux fondamentaux aux seuls « besoins de base » dont la satisfaction est discrétionnairement et politiquement décidée par l’État. N’est-ce pas la tâche que nous propose le ministre Axworthy lorsqu’il nous parle de réaliser les réformes des programmes sociaux « avant que ‘d’autres’ ne nous les imposent » ?
A partir de : Georges A. Le Bel, « Good Governance : la société civile à la rescousse des ajustements structurels », Revue Interventions économiques, 26, 1995 (extraits)
ISD - Paris
Institut Saint Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97 - 09.50.18.63.99
Autres campus :
ISD - Alpes (été / hiver)
ISD - Bourges (automne / été)
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2025 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
Satisfaction (année 2024-2025) :
Satisfaction certifiée auprès des répondants (inscrits élèves, étudiants, auditeurs libres) - Cliquer pour vérifier !
4,1/5