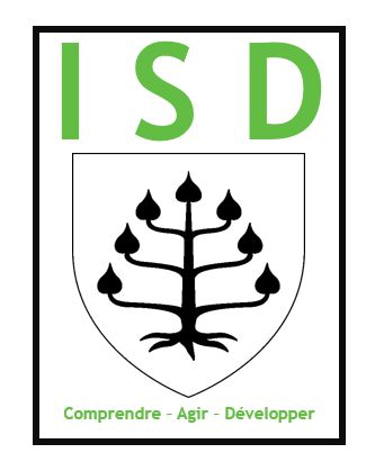Pour une meilleure expérience, privilégiez une visite sur notre site internet avant une version mobile remaniée !
URGENT : PRIVILEGIER UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR MAIL POUR TOUT RAPPEL
Corps divin et corps social, aspects et répercussions du conflit autour de la cène au XVIe siècle en Europe occidentale et centrale
Les querelles religieuses déterminent largement les formes sociales dans l'Europe de la Renaissance et leurs effets sont réels aujourd'hui... Les effets politiques et géopolitiques sont de même non négligeables. Jean-François Zorn nous explique.
PHILOSOPHIERELIGIONSHISTOIREQUESTIONS CONTEMPORAINES HISTOIRE MODERNEIEP - CONCOURS COMMUN
Jean-François Zorn
8/25/202416 min lire

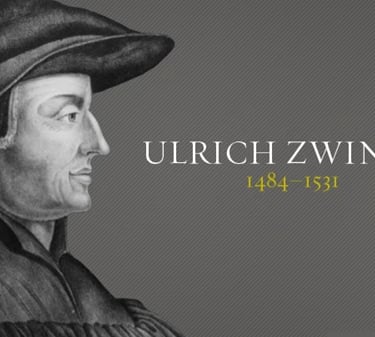
Préambule
À L’heure de la Renaissance, le conflit eucharistique se réactive dans le christianisme en Europe occidentale et centrale. Face à la « Grande Église », les protagonistes de la Réforme protestante magistérielle sont loin d’être unis et se déchirent au colloque de Marbourg (1529). En voulant maintenir le sens littéral des paroles d’institution de la cène – Hoc est corpus meum ! – contre l’interprétation symbolique de Zwingli, Luther déclenchait le processus de confessionnalisation du christianisme ; l’une de ses fonctions sera de lancer des anathèmes doctrinaux à l’encontre de l’adversaire, chrétien (catholique, protestant, anabaptiste), mais également non chrétien (juif, musulman). La partition confessionnelle qui se dessinait ainsi en Europe occidentale et centrale recouvrait aussi une partition territoriale et sociale, de sorte que le conflit d’interprétation autour de la manière d’incorporer le corps divin dans le culte alimentait le conflit autour de la construction de la nouvelle Europe politique. Levés au XXe siècle grâce au mouvement œcuménique, les anathèmes confessionnels du XVIe siècle laissent aujourd’hui encore des traces : si les frontières politiques de l’Europe ne sont plus guère religieuses, les frontières religieuses demeurent, drapées dans la recherche d’un « consensus doctrinal différencié ».
Introduction
La question des querelles eucharistiques au sein du christianisme a toute sa place dans un séminaire consacré aux relations du corps et du religieux. Depuis les origines du christianisme jusqu’au milieu du XXe siècle, cette querelle a essentiellement porté sur le type de présentification du divin dans le pain et le vin, les espèces de la célébration eucharistique. Or si aujourd’hui encore, malgré un demi-siècle de dialogue œcuménique, les chrétiens des trois principales confessions, catholique, orthodoxe et protestante, ne peuvent toujours pas participer à une même célébration eucharistique, ce n’est plus sur cette question que ces Églises affirment diverger, mais sur celles du statut du ministre qui célèbre l’eucharistie et de l’exclusivité ou non du lien ecclésial qui unit les communiants. J’en veux pour preuve, le titre d’un livre publié en 2010 émanant d’une équipe de théologiens catholiques et protestants français sensés faire à leurs Églises des propositions de dépassement du différend eucharistique. Il est titré Discerner le corps du Christ communion eucharistique et communion ecclésiale1, reléguant la question du discernement du corps du Christ dans les espèces eucharistiques aux « perceptions habituelles des catholiques et des protestants », c’est-à-dire au niveau socio-anthropologique des rituels. Or, manifestement, ce niveau n’intéresse pas les théologiens qui écrivent ce livre, mais le déplacement de nœud du différend du corps divin au corps ecclésial comme corps social qu’ils provoquent n’est ni justifié ni ne permet de comprendre comment les deux questions sont reliés, ce que cette communication voudrait au contraire montrer. (...)
Le double corps, divin et social, dans le conflit eucharistique
Vu d’aujourd’hui, le débat eucharistique médiéval paraît totalement spéculatif. Pourtant l’objet de ce débat, le pain et le vin, éléments de base de la nourriture du Palestinien de l’Antiquité, lorsqu’il se trouve théologiquement conjoint au corps et au sang de Jésus, repose sur un fait de violence religieuse avec deux conséquences : l’émergence d’une conception sacrificielle de cette mort, d’une part, et son instrumentalisation politique, d’autre part. Reprenons ces deux conséquences.
La conception sacrificielle de la mort de Jésus, tout d’abord, se fonde sur la crucifixion de Jésus, comme fait historique violent, celui du corps brisé et du sang versé d’un supplicié sur une croix ; mais ce fait devient un événement de foi dès lors que ce supplicié, parmi d’autres, est reconnu par la communauté croyante comme le Christ dont la mort sauve le croyant individuellement : le chrétien croit en effet que « Jésus est mort pour lui », c’est en cela qu’il devient le Christ. Sans doute le rituel de l’eucharistie va-t-il subvertir cette violence selon une lecture non sacrificielle de la mort de Jésus dans les textes bibliques soutenue par nombre d’exégètes et, comme on le sait, par le philosophe et anthropologue René Girard également. Mais comme Girard lui-même le reconnaît : » le christianisme historique recouvre les textes [bibliques] d’un voile sacrificiel […]. Cette lecture permet au texte [nouveau corpus] chrétien de fonder, à son tour, ce qu’en principe, il n’aurait jamais dû fonder, une culture, certes pas tout à fait comme les autres, puisqu’elle contient en elle les germes de la société planétaire qui lui a succédé, mais encore suffisamment comme les autres pour que l’on puisse retrouver en elle les grands principes légaux, mystiques et sacrificiels constitutifs de toute culture4. » Cette re sacrificialisation de la victime Jésus, équivalente pour Girard à sa re sacralisation, va reconfigurer le rituel de la messe selon la doctrine catholique médiévale, le sacrifice de la messe devenant alors le point principal d’achoppement avec la réformation protestante.
Deuxièmement, cette violence, même subvertie, à la base du rituel eucharistique, a-t-elle un rapport avec la violence de la querelle eucharistique qui surgit entre théologiens, y compris à l’intérieur d’une même confession, dès lors que cette querelle est instrumentalisée par la politique ? Ma réponse est a priori positive, mais il s’agit là d’une hypothèse que j’entends vérifier dans cette communication. C’est pourquoi je l’ai sous titré « Corps divin et corps social [j’aurais pu écrire corps politique], aspects et répercussions du conflit autour de la cène au XVIe siècle en Europe occidentale et centrale » ; quant au titre hoc est corpus meum, il s’agit de la parole de Jésus dans les Évangiles synoptiques (Matthieu 26, 26, Marc 14, 22 et Luc 22, 19) prononcée au cours d’un repas pris avec ses disciples, repas à la base de l’institution de la cène/eucharistie. Or ce verset hoc est corpus meum sera lancé par Luther à la face de Zwingli lors du colloque de Marbourg en 1529 dans des conditions et une mise en scène que je vais relater. Ce colloque de Marbourg était destiné à régler un conflit herméneutique entre Zwingli et Luther sur ce fameux verset biblique. Or il n’est pas, comme on pourrait s’y attendre, convoqué par une Faculté de théologie mais par une autorité politique, le landgrave de Saxe Philippe de Hesse, prince rallié à la réforme luthérienne. Pour montrer comment la conjonction du religieux et du politique s’opère dans cet événement, je dois préalablement rappeler quelques événements concernant l’Europe centrale dans les années 1520, les deux protagonistes du conflit, Luther et Zwingli étant respectivement saxon (allemand) et zurichois (suisse).
Les deux réformes en Europe centrale
L’espace politique dans lequel les mouvements réformateurs luthérien et zwinglien se développent au début du XVIe siècle est le « Saint Empire romain germanique » dont les frontières ont beaucoup bougé au cours des siècles et sont devenues floues au début du XVIe siècle. Par exemple, les territoires occidentaux, de l’ancienne Lotharingie ou de l’ancien royaume de Bourgogne, ne sont plus rattachés à l’Empire que par une vague tradition d’obédience. En fait d’empire, le romain germanique est devenu une mosaïque de 350 entités, territoires, villes libres, principautés ecclésiastiques à la tête desquels se trouvent des potentats dont certains sont des princes plus puissants, tels trois archevêques électeurs, des ducs, des comtes palatins, des margraves (Brandebourg, Bade), des landgraves (Hesse, Saxe, Thuringe) et un roi, Ferdinand 1er de Habsbourg, héritier d’une dynastie germanisée qui possède, outre la Bohême, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, l’Autriche. La Suisse, alors confédération de treize cantons fait théoriquement partie du Saint Empire, mais ils sont souverains. À ces cantons s’ajoutent des villes ou territoires alliés tels que Mulhouse. Certains cantons sont plus riches que d’autres ; Zürich, Bâle et Berne qui adhèrent à la réforme protestante font partie de ceux-là alors que les cantons ruraux forestiers restent catholiques. À la tête de cet empire, se trouve un empereur élu par la diète (Reichtag) composée de trois collèges, les sept princes électeurs, les autres princes et comtes séculiers, les autorités ecclésiastiques. C’est Charles Quint, frère de Ferdinand 1er, qui gouverne dans la période qui nous concerne. L’affaiblissement du pouvoir impérial est une caractéristique de cette période, du aux tensions entre les institutions de chaque territoire et le pouvoir central ; cet affaiblissement est propice à l’ascension des princes, qui autorisent l’émancipation des villes, villes d’empire, d’une part qui dépendent sans intermédiaire de l’empereur, villes libres, d’autre part. Dans les premières décennies du XVIe siècle, deux questions vont particulièrement retenir l’attention de la diète : la question religieuse posée dès 1521, lors de la comparution de Luther devant la diète de Worms qui va le mettre au ban de l’Empire et la menace turque puisqu’en 1526, Budapest est conquise par le sultan Soliman II et ses troupes apparaissent aux portes de Vienne en 1529. « La conjonction entre la division religieuse et le danger turc, écrit l’historien Marc Lienhard, est un des faits politiques marquants de l’époque ».
La comparution de Luther à la diète de Worms les 17 et 18 avril 1521 a lieu suite à plusieurs événements religieux et politiques que je me contente de rappeler succinctement :
sur le plan religieux : promulgation des thèses de Luther contre les indulgences en 1517 ; son inculpation en 1518 pour cause d’hérésie et de lèse-papauté par Rome suite à sa comparution devant le cardinal Cajetan puis sa condamnation par le pape Léon X ; la dispute de Leipzig en 1519 qui met Luther aux prises avec le théologien Jean Eck ; sa condamnation la même année par la Faculté de théologie de Cologne et par la bulle Exsurge Domine du 15 juin 1520 ; dans les mois qui suivent, Luther écrit les quatre premiers grands textes de la réformation, dont le troisième Prélude sur la captivité babylonienne de l’Église dans lequel il soutient que l’eucharistie est victime d’une « triple captivité » de la part de l’Église, captivité de la doctrine des ministères, captivité de la doctrine de la transsubstantiation, captivité de la doctrine sacrificielle ; le 10 décembre 1520 Luther brûle la bulle ; le 3 janvier 1521, il est excommunié par la bulle Decet romanum pontificem.
Sur le plan politique : Luther est originaire du comté de Mansfeld en Saxe dont le prince électeur, Philippe de Hesse, est en train d’accroître son pouvoir en remplaçant, par exemple ses anciens conseillers d’origine noble, par des juristes professionnels, ou en se mêlant, autre exemple, de la réforme des couvents.
À la fin de la diète de Worms, sentant Luther en danger, Philippe de Hesse simule son enlèvement et le met à l’abri au château de la Wartburg. Mais le 26 mai 1521, en l’absence de Philippe de Hesse et de plusieurs notables de la diète favorables à la réforme, l’empereur édicte un décret mettant Luther au ban de l’empire et ordonnant l’autodafé de ses écrits. La publication, et plus encore l’application du décret de Worms, se heurtent à des résistances souvent très vives, les prédicateurs évangéliques étant de plus en plus soutenus par les autorités temporelles. Ce sont plutôt les réponses que le message luthérien apporte sur les plans religieux et sociaux qui peuvent expliquer son succès que ses critiques bien connues de l’Église traditionnelle.
La suite est connue et quasi légendaire : deux diètes de Spire vont installer la réformation en Allemagne, En 1526, La première stipule « que chaque État se comporte en matière religieuse comme il croit pouvoir le justifier devant Dieu et devant sa majesté ». En fait, elle contraint l’empereur de laisser à chaque prince le droit d’imposer sa confession, catholique ou évangélique, aux ressortissants de son territoire, selon le principe du cujus regio ejus religio qui prévaudra définitivement en 1555 avec la paix d’Augsbourg. (...)
En 1522, la rupture de Zwingli avec l’Église romaine est engagée. Il organise des disputes religieuses desquelles sort une succession de textes où il développe sa nouvelle théologie et ses vues sur la société : Dans Apologeticus Architeles (Premier et dernier mot pour ma défense) de 1522, il affirme que, prisonnière des lois humaines, la hiérarchie ecclésiastique ne peut plus juger et que l’Écriture est la seule autorité ; dans Auslegen und Gründe der Schlussreden de 1523, qui pose les fondements de 67 thèses et en donne le commentaire, pamphlet assez comparable aux 95 thèses de Luther, Zwingli affirme que la messe n’est pas un sacrifice mais le mémorial du sacrifice du Christ ; dans Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit (De la justice divine et de la justice humaine) de 1523, il développe ses positions sur la justice ; en substance Zwingli distingue bien deux types de justice, l’une divine, l’autre humaine ; la première est conforme à la volonté de Dieu et concerne la relation de l’homme à Dieu, d’où son caractère intérieur, justice que le péché de l’homme ne permet pas de réaliser à l’extérieur ; la seconde, la justice humaine, est basée sur un ordre social garanti par l’autorité civile. Cette justice humaine est néanmoins ordonnée par Dieu ; puisque l’homme ne peut réaliser la justice divine, Dieu autorise l’autorité civile à punir ceux qui enfreignent la justice humaine. Là où Luther opposait les deux règnes, de Dieu et de l’homme, Zwingli pose un pont entre les deux, le règne de Dieu conférant au gouvernement civil une autorité dans l’organisation de la société. Zwingli prône en fait une forme nouvelle de théocratie dans laquelle un pouvoir civil fort se constitue.
Zwingli sort pratiquement victorieux des disputes théologiques qu’il avait organisées, y compris contre les anabaptistes dont il obtint une féroce répression de la part des autorités civiles. À partir de 1525, en même temps qu’avec ses partisans il fait abolir progressivement toutes les manifestations du culte catholique, il participe à l’instauration d’un tribunal matrimonial, le Ehegericht qui remplace le droit canon par un code civil. Le ralliement des autorités civiles à sa cause est achevé en 1528, date à laquelle Zwingli se rend maître de la ville en fondant un conseil secret de six membres qu’il dirige lui-même.
Pendant ce temps, encouragés par les résultats de la diète de Spire, les cantons suisses restés catholiques commençaient à bouger. Le 22 avril 1529, ils concluent avec l’Autriche l’« Union chrétienne » pour la défense de la foi et la répression de l’hérésie. Plusieurs événements graves se produisent alors : Jacob Kaiser, un pasteur de Zürich, est brûlé vif le 29 mai 1529 à Schwyz. En réplique, la même année, une vague d’iconoclasme s’abat sur la Suisse, l’abbaye de Saint-Gall et la collégiale de Neuchâtel sont dévastées par les partisans de la réforme. Le polémiste franciscain alsacien Thomas Murner, répand ses pamphlets contre Luther.
« L’heure parut propice à Zwingli pour réaliser un plan d’offensive protestante », écrit Léonard7. Il fait proclamer la mobilisation générale pour le 4 juin 1529 et amène lui-même la hallebarde à l’épaule l’armée zürichoise à la frontière des cantons forestiers, tandis que les forces catholiques, moins nombreuses, étaient cantonnées, non loin de là. Mais les alliés sur lesquels les deux partis devaient compter – les Bernois pour les protestants et les Autrichiens pour les catholiques – firent défaut et les autorités des deux camps amenèrent, le 26 juin 1529 à Kappel, les belligérants à signer un compromis allant plutôt dans le sens des protestants : dans les baillages communs, la réforme pouvait continuer à s’étendre ; les cinq cantons catholiques devaient renoncer à leur alliance avec Ferdinand Ier. Toutefois, Zwingli n’obtint pas l’autorisation du culte protestant sur le territoire des cantons catholiques. Selon la tradition, les soldats des deux camps auraient partagé sur la frontière qui les séparait une soupe faite de lait et de pain, préparée dans un grand chaudron ; cette anecdote de la soupe au lait en est venue à symboliser l’esprit de compromis des Confédérés. La Suisse paraissait donc entrée, elle aussi comme l’Allemagne, dans la bi confessionnalité, mais non sans mal, Lors d’une deuxième guerre de Kappel en 1531, cette fois-ci provoquée par les cantons catholiques, près de 600 hommes tombèrent, Zwingli lui-même qui participait au combat comme aumônier, fut tué et brûlé comme hérétique…
Le débat Luther Zwingli au colloque de Marbourg
Vraie ou légendaire, cette sorte de communion au pain et au lait entre adversaires lors de la première paix de Kappel en juin 1529, me permet une transition, facile j’en conviens, avec une autre communion au pain et au vin qui devait, cette fois-ci, mettre aux prises Zwingli et Luther lors du colloque de Marbourg convoqué, comme je l’ai écrit plus haut, par Philippe de Hesse du 1e au 4 octobre 1529. (...)
Quant à moi, je voudrais, en conclusion, faire quelques remarques sur ce conflit, mais surtout étayer mon hypothèse sur les liens entre ce débat théologique sur la présence du corps du Christ et la question politique de la construction du corps social et politique européen à l’époque de la réformation.
Remarques conclusives
Première remarque : dans le débat où Luther et Zwingli se jettent à la figure deux versets bibliques, le premier le fameux hoc est corpus meum des Évangiles synoptiques, le second le Spiritus est, qui vivificat : caro non prodest quidquam de l’Évangile de Jean (6/63 - C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien), chacun revendique pour lui la clarté de l’Écriture et stigmatise l’erreur de la lecture adverse. Or, comme on le voit, cette clarté prétendue normative de l’Écriture, par principe impérative et contraignante, ne fonctionne pas et met au jour un débat typiquement protestant autour du principe du sola scriptura.
Deuxième remarque : la controverse exégétique est donc, en fait, une controverse herméneutique, Luther interprétant de manière nominaliste (je ne dis pas fondamentaliste) son verset alors que Zwingli l’interprète de manière conceptualiste ou spiritualiste. Pour Luther ce qui est célébré dans la cène est l’être de la chose (le corps du Christ) alors que pour Zwingli, on ne célèbre que ce que signifie la chose. On comprend que Luther ne puisse donc pas se détacher de la chose, ni les détacher, en séparant le corps du Christ du pain, le sang du Christ du vin, alors que Zwingli se détache de la chose et ne peut envisager une union du corps du Christ au pain et de sang du Christ au vin autrement qu’en esprit.
Troisième remarque, chacun on le voit éclaire donc la question de la présence du Christ dans la cène de manière différente : pour Luther c’est dans l’union de la réalité corporelle et de la réalité spirituelle du Christ que se vit l’expérience de l’humanité divine du Christ, position que j’ai qualifiée plus haut d’existentielle. Cette position donne naissance à la doctrine de l’eucharistie comme consubstantiation. Pour Zwingli, l’expérience de l’humanité du Christ se vit dans la commémoration et la « suivance » de l’œuvre du Christ, position que j’ai qualifiée d’éthique. Cette position donne naissance à la doctrine de l’eucharistie comme mémorial.
Quatrième remarque qui a trait directement au sujet du séminaire sur le corps et le religieux et plus particulièrement à celui de l’incarnation. Comment le divin invisible se présentifie à l’humain visible à travers les choses extérieures, les espèces pain et vin, l’eau du baptême, mais également tous les rituels religieux ? Manifestement ces choses extérieures ont un statut différent chez Luther et chez Zwingli : pour Zwingli, influencé par une pensée dualiste, il y a un certaine dévalorisation, relativisation, de ce qui est physique et visible, alors que pour Luther, comme l’écrit Marc Lienhard : « Ces éléments sont parfaitement aptes à transmettre les choses divines à l’homme et à être salutaires pour qui en use dans la foi ».
Alors tout ceci me ramène à mon hypothèse : est-il possible de corréler les conceptions luthérienne et zwinglienne du corps du Christ à leur conception du corps social ou politique ? Pour répondre positivement à cette question, il faut d’abord bien voir que les deux théologiens n’ont pas la même manière d’accéder à l’événement rédempteur du Christ célébré dans l’eucharistie. Il faut ensuite en tirer les conséquences pour l’action, à savoir que les deux réformateurs n’utilisent pas cet événement de la même manière dans la vie sociale et politique : l’un le fait sur le mode de la sagesse, qui barre l’accès à toute instrumentalisation politique du message du Christ, l’autre le fait sur le mode prophétique qui ouvre l’accès à l’engagement sans limite à la suite du Christ. En substance, chez Luther, le Royaume de Dieu incarné par le Christ est séparé du Règne de l’Homme de sorte qu’il n’y a pas de continuum possible entre les deux règnes. Cette posture ménage déjà un espace pour la laïcité, malgré le fait que l’on se trouve encore en période de chrétienté, espace qui n’exclut pas un engagement du chrétien, mais en tant que citoyen et non en tant que croyant. À l’inverse la posture zwinglienne instaure quasiment une continuité entre les deux règnes qui permet d’imaginer une théocratie, une république chrétienne avec les justifications théologiques à la clef de ses actions politiques, y compris violentes. Pas étonnant donc de voir Zwingli prendre les armes pour défendre la cause de la réformation et mourir sur un champ de bataille, donnant ainsi son propre corps en sacrifice. Alors que Luther mourut malade, convaincu de la fin imminente du monde, pourfendant ses adversaires, le pape, les juifs, ceux qui l’avaient trahi, les princes. Jusqu’au milieu du XXe siècle les thèses, catholiques principalement, perpétuèrent l’explication de sa mort par ivresse ou par suicide. Quoiqu’il en soit, entre les hagiographies et les légendes noires, on se perd en conjecture. Mais Luther a souvent parlé de sa mort et du destin de son corps. En 1535, il s’est comparé à « un sac pourri et inutile, destiné aux vers » ou à « un cadavre froid auquel il ne reste que le sépulcre ». Dans l’un de ces fameux Propos de table prononcé le 16 février 1546, deux jours avant sa mort, il aurait déclaré : « Dès que je serai rentré à Wittenberg, je me coucherai aussitôt au cercueil et donnerai aux vers un docteur bien gras à manger ». Alors que Zwingli a donné son corps en changeant le monde, Luther a abandonné son corps en changeant de monde.
REMARQUES : texte remanié, avec l'aimable accord de leurs ayant droits ; à partir de : Jean-François Zorn, « Hoc est corpus meum ! Corps divin et corps social, aspects et répercussions du conflit autour de la cène au XVIe siècle en Europe occidentale et centrale », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 14 | 2015.
SUR MOODLE : version simplifiée et applications aux programmes de Seconde, Questions contemporaines (Concours commun) et en culture générale pour les concours à Bac+2/3 et concours administratifs.
ISD - Paris
Institut Saint Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97 - 09.50.18.63.99
Autres campus :
ISD - Alpes (été / hiver)
ISD - Bourges (automne / été)
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2025 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
Satisfaction (année 2024-2025) :
Satisfaction certifiée auprès des répondants (inscrits élèves, étudiants, auditeurs libres) - Cliquer pour vérifier !
4,1/5