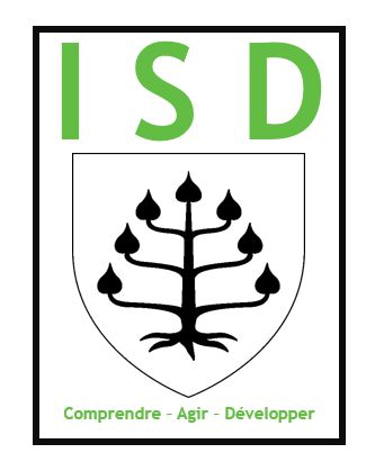Pour une meilleure expérience, privilégiez une visite sur notre site internet avant une version mobile remaniée !
URGENT : PRIVILEGIER UNE DEMANDE D'INFORMATION PAR MAIL POUR TOUT RAPPEL
Accepter les juges constitutionnels ?
François Luchaire propose depuis longtemps d'accepter que nous sommes entrés d'une certaine manière dans le "gouvernement des juges" (Edouard Lambert). Il l'évoque dans la Revue de science administrative de la Méditerranée occidentale (IRA de Bastia, 1987). En France, dans la société de défiance, juger les juges qui jugent les politiques a depuis été un débat parmi les plus houleux. Mais revenons sur les arguments clés pour justifier ce rôle du juge à propos de la constitutionnalité des lois. Aujourd'hui, ces arguments continuent de peser.
ACTUALITÉS CULTURE GÉNÉRALE ECOLES DE COMMERCESCIENCES SOCIALES ET MORALESDROIT
François Luchaire
8/19/20259 min lire


Il ne faut pas regretter la jurisprudence du Conseil constitutionnel bien qu’elle conduise au Gouvernement des juges et cela tout simplement parce que c’est la moins mauvaise des solutions permettant d’assurer une protection effective des droits et libertés constitutionnellement garantis. Pourquoi ? Pour des raisons d’ordre technique mais aussi pour des raisons d’ordre politique.
Les raisons techniques
Ces raisons sont au nombre de trois ; chacune d’elles correspond à chacun des éléments permettant de dire que la France est partiellement gouvernée par des juges.
a) La première de ces raisons concerne le choix des normes de référence : les critiques adressées au Conseil reposent sur le fait que celui-ci n’applique pas un document unique clair, adopté à notre époque et précisant nettement les limites que le législateur ne doit pas dépasser ; on voudrait souvent, à gauche comme à droite, une nouvelle Charte des libertés ou si l’on veut une définition moderne des règles du jeu. Après la libération et la Seconde Guerre mondiale, la première Assemblée constituante avait voté le 19 avril 1946 une nouvelle Déclaration des droits de l’homme qui figurait en tête du projet de Constitution proposé au peuple français lors du référendum du 5 mai 1946 ; cette Déclaration incorporait – très heureusement à mon sens – dans un document unique les principes de 1789, ceux résultant des grandes lois républicaines de la fin du xixe et du début du xxe siècle, ainsi les principes très sociaux affirmés à la veille de la guerre de 1939-1945 ; mais ce projet fut rejeté par le référendum précité. La nouvelle Assemblée constituante ne reprit pas ce document unique ; la Constitution du 27 octobre 1946 se contente de se référer à la Déclaration de 1789, aux principes fondamentaux (sans les citer) reconnus par les lois de la République, complétés par des « principes politiques, économiques et sociaux » que le Préambule constitutionnel énumère et proclame comme particulièrement nécessaires à notre temps ; c’est aussi à cet ensemble que se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.
Est-il possible aujourd’hui de reprendre l’idée d’un document unique adopté à la société française contemporaine ? Théoriquement oui bien sûr ; mais pratiquement non ; une nouvelle Charte des libertés n’aurait d’intérêt – et de valeur – que si son adoption fait l’objet d’un large consensus ; imposée par une majorité de droite elle apparaîtrait trop conservatrice, imposée par une majorité de gauche elle apparaîtrait trop progressiste ; elle serait donc rejetée par la moitié du pays et, à chaque alternance politique, une nouvelle majorité voudrait la bouleverser ; dans la conjoncture politique actuelle c’est là une œuvre impossible à réaliser ; même si les coalitions tendent à mettre de côté leurs idéologies pour mieux gérer le pays, aucune d’elle n’accepterait de mettre à l’écart ces mêmes idéologies pour définir des principes. Dans ces conditions, si l’on veut protéger efficacement les droits et libertés de la personne humaine, mieux vaut laisser les sages du Conseil constitutionnel – en présumant que ce sont des vrais sages – adapter progressivement aux conditions de la vie contemporaine, des principes mêmes anciens, mêmes abstraits, mêmes contradictoires. Il n’est pas possible de faire autrement et cela d’autant plus que les rapports humains évoluent, sans cesse, à une cadence de plus en plus rapide.
b) Interpréter la loi, préciser ce qu’elle ne permet pas de faire ou ce que l’on doit faire pour l’appliquer sans porter atteinte aux droits et libertés, cela vaut mieux que de l’annuler ; la volonté du législateur paraît ainsi mieux respectée ; mieux vaut guider et assouplir que s’opposer. De plus, si une loi est imprécise, il n’est pas mauvais qu’une seule autorité apporte, avant même sa promulgation, les précisions nécessaires ; s’il n’en était pas ainsi, la même loi serait différemment appliquée par l’Exécutif et l’administration, par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs et même par chaque citoyen ; il n’y aurait plus de sécurité juridique pour personne.
Enfin, dans le climat politique actuel, en grande partie déterminée par le scrutin majoritaire (qui n’est nullement condamnable d’ailleurs), le consensus entre les deux grandes coalitions politiques est rarement recherché dans les enceintes parlementaires ; au contraire, au Conseil constitutionnel composé d’hommes courtois qui se connaissent bien et s’apprécient mutuellement, un certain consensus est tout naturellement recherché ; entre ceux qui interprètent la Constitution dans un sens favorable à la loi soumise au Conseil et ceux qui au nom d’une autre interprétation de la Constitution la condamnent, l’accord peut se faire par la technique de la conformité sous réserve ; les partisans de la loi sont satisfaits puisque la loi est déclarée conforme à la Constitution ; les adversaires de la loi sont aussi satisfaits puisque les réserves en donnent une « interprétation neutralisante » ou la débarrasse du « venin » qu’ils y trouvent. Il est parfaitement possible de considérer que ce genre de consensus correspond finalement au désir du pays ; c’est du moins ce que les sondages font apparaître.
c) Il est plus difficile de répondre à la troisième critique : il est exact que le Conseil juge l’opportunité de certaines lois en substituant sa propre appréciation à celle du législateur ; certes, il le ne fait pas systématiquement ; mais le fait même qu’il décide lui-même s’il doit ou non contrôler cette opportunité, constater une erreur manifeste, apprécier une nécessité, l’objectivité d’un critère, ou la justification d’une distinction, soulève l’irritation du législateur qui se plaint de ne jamais savoir à l’avance si sa décision sera acceptée ou refusée. Il faut cependant constater que les juridictions constitutionnelles des autres pays exercent un contrôle encore plus strict que le Conseil constitutionnel : le tribunal constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne condamne des mesures qu’il estime « arbitraires » ou dépourvues de « justifications raisonnables » ; la Cour Constitutionnelle italienne rend des « sentences manipulatrices » qui substituent une règle conforme à la Constitution à la règle votée par le législateur mais que la Cour condamne.
Certes, ces décisions sont aussi très critiquées mais avec cependant moins de passion qu’en France et cela pour une raison évidente : dans notre pays le contrôle se fait aussitôt après le vote de la loi et avant sa promulgation ; c’est heureux car il n’y aurait pas de sécurité juridique si une loi pouvait être annulée après plusieurs mois ou après plusieurs années d’application ; mais ce contrôle s’effectue alors que les passions entraînées par le débat parlementaire ne sont pas apaisées ; ce contrôle apparaît aussi comme une dernière phase du processus législatif. Au contraire dans les autres pays le contrôle n’est pas le plus souvent préalable à l’application de la loi ; c’est un contrôle a posteriori ; il intervient alors que le phare de l’actualité n’est plus braqué sur la loi. Techniquement le système français est cependant meilleur ; dans quelle situation se trouverait-on si plusieurs mois après une nationalisation ou une privatisation, la loi qui la décide était anéantie ? Comment revenir au statu quo ante ?
Des raisons politiques
Ces raisons sont également au nombre de trois ; chacune d’elles repose sur une certaine évolution, évolution des rapports entre les pouvoirs, évolution dans les conditions de la compétition démocratique, évolution enfin des rapports internationaux car la protection des droits et libertés n’est plus une affaire purement nationale.
a) La séparation des pouvoirs a changé de nature. Pour Montesquieu la séparation des pouvoirs était une maxime d’art politique permettant d’assurer la liberté ; la Déclaration de 1789 accomplit le même rapprochement en disposant dans son article 16 que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de Constitution » ; pour reprendre une autre expression de Montesquieu, quiconque a du pouvoir est porté à en abuser ; pour protéger la liberté il faut donc que le pouvoir freine le pouvoir. Or aujourd’hui le législatif, c’est-à-dire le Parlement, ne freine plus l’Exécutif c’est-à-dire le gouvernement ; le second en France comme dans d’autres pays et par exemple en Angleterre, sûr de disposer à l’Assemblée nationale d’une majorité fidèle, dirige toute l’activité législative ; il y a donc confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs ; le frein si nécessaire pour garantir la liberté ne peut alors provenir que du pouvoir juridictionnel. En 1958 le Conseil constitutionnel avait reçu pour mission essentielle de défendre les prérogatives de l’Exécutif contre un Parlement soupçonné – comme il l’avait fait dans le passé – de les réduire à néant ; mais cette tâche s’est révélée sans intérêt et bien inutile puisque le soupçon n’était pas fondé et que jusqu’à présent, avec la Ve République, le gouvernement n’a à peu près rien à craindre du Parlement. On comprend alors que le Conseil constitutionnel se soit consacré à une mission beaucoup plus nécessaire consistant à défendre les droits et libertés de la personne humaine contre un pouvoir réunifié qui, sans lui, ne connaîtrait plus de borne.
b) La compétition démocratique n’est plus ce qu’elle était jadis lorsqu’un « centre » politique important s’alliait tantôt avec une droite modérée tantôt avec une gauche assagie et assurait ainsi à la politique française une certaine continuité (et il est vrai lui donnait une certaine tendance à l’immobilisme) malgré l’instabilité gouvernementale ; en effet, l’élection du président de la République au suffrage universel direct et nécessairement majoritaire partage la France en deux ; chacun d’eux est tout naturellement attiré par ses extrêmes ; or ceux-ci qu’ils soient de droite ou de gauche apparaissent à beaucoup plein de menaces pour les libertés. En garantissant le respect de ces dernières le Conseil constitutionnel diminue sensiblement et ce risque ou cette crainte. L’alternance au pouvoir est nécessaire à la démocratie ; sans elle une trop grande partie de la population voyant que ses représentants n’ont aucune chance d’accéder au pouvoir est alors tentée de s’exprimer autrement que par le bulletin de vote et notamment par la violence ; assurer le respect des droits et libertés quelle que soit la majorité en place et donc même si cette majorité devient minorité, c’est donc faciliter l’alternance et, par là même, mieux attacher l’ensemble des citoyens à la démocratie. Les droits et libertés constitutionnellement garantis sont voulus par la très grande majorité de la population ; ils réunissent autour d’eux un consensus indéniable ; en assurer le respect c’est garantir que si la coalition au pouvoir tendait trop vers ses extrêmes, le juge constitutionnel empêcherait le plateau de la balance de trop pencher d’un seul côté ; c’est donc faciliter et l’alternance et une certaine continuité et ainsi toujours la démocratie.
c) Les droits et libertés ne sont plus aujourd’hui seulement protégés par la société nationale ; ils le sont aussi par la société internationale. Les documents internationaux dans ce domaine se sont multipliés :
c’est la Déclaration universelle des droits de l’homme votée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 mais qui n’a pas en France valeur de droit positif ;
c’est la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, ratifiée et publiée par la France ainsi que ses protocoles annexés ;
ce sont les deux pactes adoptés le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies ; l’un porte sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques, sociaux et culturels ; ces deux pactes ont été également ratifiés et publiés par la France (décret du 29 janvier 1981).
Or ces documents établissent des procédures internationales conduisant des organismes internationaux à condamner les atteintes aux droits et libertés dans les pays signataires ; Cour européenne des droits de l’homme au Comité des droits de l’homme des Nations unies. Plutôt que de se voir traduit devant ces enceintes internationales, notre pays (comme les autres pays signataires) peut donc raisonnablement préférer des procédures nationales garantissant qu’aucune loi contraire aux droits et libertés ne sera promulguée. Mieux vaut balayer soi-même son appartement que d’inviter même les meilleurs voisins à y procéder. Si le Parlement accepte mal qu’un juge français censure la loi qu’il a votée, que dirait-il si cette loi était condamnée par un juge ou un organisme international ? La France et l’Europe occidentale soutiennent dans les organismes internationaux que le principe de la non immixtion dans les affaires intérieures d’un pays ne peut être opposé à l’application des conventions internationales protectrices des droits de l’homme.
La France a toujours affirmé la valeur universelle des droits et libertés de la personne humaine ; comment serait-elle crédible, comment son message universaliste pourrait-il être accepté, si elle ne donnait pas elle-même l’exemple de la plus grande rigueur dans ce domaine et notamment si elle ne reconnaissait pas au juge constitutionnel le pouvoir de s’opposer aux lois contraires à ces lois et libertés ? Non, la France ne serait plus la France si elle n’assurait pas elle-même sur son propre sol la protection constitutionnelle et juridictionnelle des droits et libertés qui font la dignité de la personne humaine.
SOURCE - A partir de Texte publié dans la Revue de science administrative de la Méditerranée occidentale, Institut régional d’administration de Bastia, 1987, n° 19-20.
ISD - Paris
Institut Saint Dominique
Siège permanent : Paris XVII
www.isd-france.eu
Mail - Courriel : Isdaccueil@gmail.com
Téléphone : (+033) - 06.85.02.47.97 - 09.50.18.63.99
Autres campus :
ISD - Alpes (été / hiver)
ISD - Bourges (automne / été)
Suivez-nous sur :
L'ISD, bien plus qu'une Prépa !
ISD © 2024-2025 - Site hébergé par Hostinger.com
(Voir les mentions légales dans nos CGV - CGU)
Satisfaction (année 2024-2025) :
Satisfaction certifiée auprès des répondants (inscrits élèves, étudiants, auditeurs libres) - Cliquer pour vérifier !
4,1/5