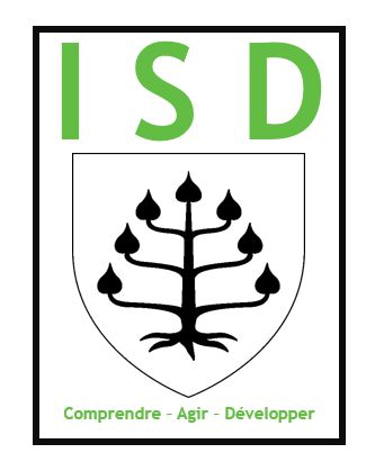AOÛT : NOUVEAU SITE MOBILE A JOUR !
ATTENTION : session de juillet ; dernières inscriptions possibles !
Sylvain Gouguenheim, Constantinople, 1453 (Perrin) - ISD-Lab
Découvrez le compte-rendu du dernier ouvrage de Sylvain Gouguenheim, médiéviste sur une lecture "civilisationnelle", Constantinople - 1453, par France Jacquet pour l'ISD-LAB
Franck Jacquet
6/20/20247 min read
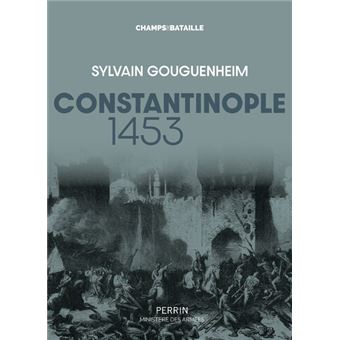
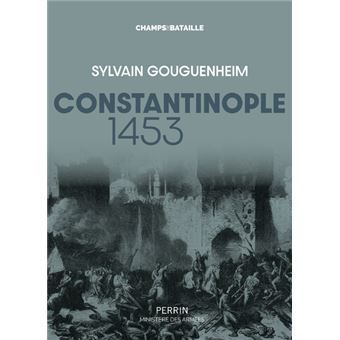
L'histoire d'une bataille qui "vient de loin"
L'ouvrage se situe parfaitement dans la veine de la collection : l'auteur nous restitue avec force sources et points de vue confrontés les raisons d'une bataille finale qui se déroule comme un siège de plusieurs mois, mais qu'on pourrait en réalité comprendre comme un étouffement progressif par l'essor turc (et pas simplement), avec quelques moments de respiration dus notamment au surgissement mongol au XIIIe siècle. Les échelles temporelles reviennent sans cesse préciser le contexte et la signification majeure de cette prise :
L'empire est en déclin depuis bien longtemps et ce sur tous les plans ; il est attaqué à l'extérieur comme à l'extérieur et la perte de son arrière-pays immédiat, l'Asie Mineure, ne peut que le condamner à moyen terme lorsque l'essor du royaume d'Osman se fait jour
Alors qu'au même moment, ce qui n'est jamais évoqué dans l'ouvrage, les Latins et donc les chrétiens prennent pied dans la péninsule ibérique et finissent par quasi-chasser les royaumes arabes à l'heure de la chute de Constantinople, ici il s'agit d'une zone de repli ; la Reconquista ne semble avoir aucun effet sur les discours, les prises de position ou autres... Aragon est même un ennemi
Timidement, sans semble-t-il l'avoir construit, quelques témoins ou hiérarques orthodoxes notamment de Kiev instaurent l'idée d'une troisième Rome, Moscou désormais, débarrassée de ces croyances antiques pré-chrétiennes et de cette culture grecque qui n'a jamais complètement disparu et qui annonce un retour vers une orthodoxie sans compromissions, avec les Occidentaux, avec les mœurs arabo-musulmanes qui ne sont pas complètement extérieures dans une société attachée à la confession orthodoxe jusqu'à refuser l'Union des Eglises avec l'Occident pour être sauvée, mais fière de se voir encore comme romaine et héritière de l'Antiquité
L'heure du djihad, qui n'a été que de manière très rare utilisé au Xe siècle en "guerre sainte" du côté des byzantins, est bien là avec le souverain turc qui doit d'ailleurs composer avec une cour pas toujours favorable à cette bataille pour des murailles réputées imprenables et effectivement qui ont tant résisté depuis de nombreux siècles
On voit donc à quel point les raisons sont nombreuses, mais ce qui se produit à partir de la fin du XIVe siècle est la congruence et l'accumulation de toutes ces raisons qui s'ancrent dans des temporalités différentes, si bien que la bataille, parfois débutée, jamais réellement menée, souvent esquissée pour une ville depuis longtemps affaiblie, se déroule là et maintenant, au printemps 1453. Echelles de temps et intrications des causalités... auxquelles les occidentaux ne sont pas étrangers.
Maudits Latins
En effet, les Occidentaux ou Latins, bien au-delà des Génois et des Vénitiens qui ont pris longtemps en gestion le quartier de la capitale de Péra, jusqu'à en contrôler la défense (en l'occurrence les génois), apparaissent, et une longue veine de sources le montre, un véritable facteur d'affaiblissement de l'Empire. Bien évidemment, mais cela reste peu évoqué, avant 1203-1024 et la croisade qui mena les armées croisées à prendre Constantinople, à la piller et à remplacer pour quelques décennies l'Empire byzantin par l'Empire latin d'Orient.
L'une des grandes forces de l'ouvrage est de confronter les sources, des chroniqueurs, témoins directs ou indirects, mais latins et orientaux et turcs. Cela nous rappeler combien les marchands dans les villes mais aussi les chefs féodaux dans les campagnes et une partie de l'Empire, ont conservé longuement leur ancrage territorial, culturel et économique ou militaire, voir politique par des alliances matrimoniales. Cette dernière, tactique si féconde pour les Habsbourg, ne fut pas franchement un succès pour Constantinople...
On revient donc sur les motifs récurrents de l'affaiblissement de l'Empire qui n'a jamais su se remettre de l'éclipse de 1205-1261, mais pas sur l'emprise des modèles patrimoniaux (séparation des fiefs) qui a ensuite marqué la pratique byzantine et a divisé les forces entre Morée, Trébizonde, Capitale, Thrace et autres territoires reconquis. Sur cet aspect comme sur bien d'autres, alors qu'un chroniqueur repris de-ci ou de-là proclame qu'il y a une préférence pour une domination turque que latine, en réalité des métissages, des échanges à minima et des transferts culturels ont eu lieu tantôt avec les Catalans, les vénitiens, des hongrois hésitant entre Occident et Orient..., ce qui éloigne encore plus les points de vue des derniers hiérarques byzantins des dirigeants de la dynastie d'Osman.
De même est évoquée lors de la bataille finale, alors que le siège semble remarquablement tenu, l'un des points de bascule fatals qui fait le sort des habitants : la blessure du capitaine génois qui selon les sources proclame lui-même la défaite en effrayant les défenseurs, ou au contraire s'effondre avant d'être transporté à l'arrière, ce qui démobilise ses proches alors qu'il n'a pas de nommé de second. Pour la mémoire du siège et de ceux qui se pensent héritiers de l'Empire millénaire, c'est essentiel. Mais d'une part Sylvain Gouguenheim rappelle la disproportion des forces et le principe de réalité malgré les recherches de signes divins (de part et d'autre), la modernité du côté assaillant avec les pièces d'artillerie propres à la Renaissance (un peu comme la "descente" des Français en Italie à la fin du siècle) et la réunification des esprits seulement lorsque l'on pense que le sort en est joué des vies comme de la a Ville. Si la grande capitale a tenu, c'est aussi parce que les latins, affaiblissant le trésor impérial par leurs monopoles, ont mis à disposition leur domination thalassocratique contre les turcs encore faibles sur cet élément, parce qu'ils ont combattu aux côtés des Paléologue et des Cantacuzène qui s'entre-déchiraient parfois entre fils et pères... L'image est là, les racines du pouvoir des "latins" déstabilise structurellement les fondements de la société et du pouvoir byzantin, mais en l'enserrant, conservent ses morceaux encore liés les uns aux autres comme pour retarder leur effondrement, lequel semblait écrit... D'ailleurs, jusqu'au bout une flotte pouvait venir desserrer l'étau et des négociations avaient lieu avec les plus grandes dynasties européennes pour obtenir de l'aide.
La fin d'une ombre ?
Dès lors, que retenir de ce récit saisissant, réaliste, appuyé rigoureusement sur une démonstration claire et étayée ? Tout ce qu'on évoque précédemment. Mais on pourrait nuancer certains aspects rapidement, lesquels correspondent bien aux objets et vues de recherche auxquels l'auteur nous a habitués depuis son Aristote ou même son Frédéric II (qui est mentionné à plusieurs reprises) :
Constantinople prise, c'est sans aucun doute une rupture pour les habitants mais moins pour l'ensemble du monde comme l'auteur l'évoque lui-même. Mais il réduit sans aucun doute la portée de l'événement pour tous les peuples balkaniques et surtout leurs voisins hongrois et autrichiens qui développent à partir de cette prise (et même déjà avant) des récits eschatologiques majeurs pour expliquer les formes de résistance qui se font jour durant les siècles suivants et qui bloquent les Turcs, comme par exemple Clarisse Roche l'a démontré. Cet aspect semble vite passé dans la dernière partie du livre, s'étalant un peu sur la longue idée grecque de reprise de la Ville.
Constantinople était au XVe siècle l'ombre de ce qu'elle fut, certes. Mais comment réduire à ce point la période Comnène, son empreinte et la reconquête de la fin du XIIIe siècle comme l'auteur le fait, avec l'émergence d'une nouvelle manière de défendre la frontière par une forme de colonisation militarisée ?
Ensuite, les départs et fuites du sièges, dont de grands penseurs et hiérarques ou alors certains faits esclaves mais libérés après paiement de leur rançons... Ils se retrouvent en Occident, mais on insiste peu sur leur poids dans l'élan des lettres, des mathématiques, des connaissances antiques y compris par la connaissance du grec. Certes, le mouvement débute plus tôt (bien plus tôt), mais l'histoire des idées et des sciences depuis quelques décennies a mis au jour l'important apport pour expliquer ce renouvellement de la pensée occidentale par l'apport oriental, ce qui ne semble pas du tout évoqué ou à peine lorsque l'ouvrage évoque l'impact en Occident, qui n'aurait développé que des lamentations de façade ou du moins superficielles... Comme si l'auteur voulait rappeler que le fil essentiel du passage des idées et des maîtres antiques d'Est en Ouest s'était fait plus tôt, essentiellement par l'effort de traduction des Occidentaux, notamment dans les couvents et centres religieux...
Au total ce riche ouvrage méticuleux et clair notamment dans les derniers rapports de pouvoir avec l'extérieur de Constantin Dragasès et ses prédécesseurs et ses voisins, minore quelquefois sans aucun doute le poids des formes culturelles de l'implantation occidentale en Méditerranée orientale, limite la portée de l'événement pour relancer l'apport de l'Orient aux sciences et lettres de l'Occident tout en décrivant et analysant clairement les intrications du jeu local qui ont finalement permis de retarder, dans le cadre des relations interpersonnelles, la bataille finale, impressionnante plus dans les esprits que par sa portée géopolitique : l'Occident était porté vers l'Ouest et l'Afrique, le Nord vers le Nord-Est, les Turcs veulent devenir un empire-monde autour de la Méditerranée, leur prochain ennemi à éliminer étant le sultanat mamelouk... Byzance était un reliquat, mais un reliquat qui fit énormément sens pour l'Occident au XVe siècle.